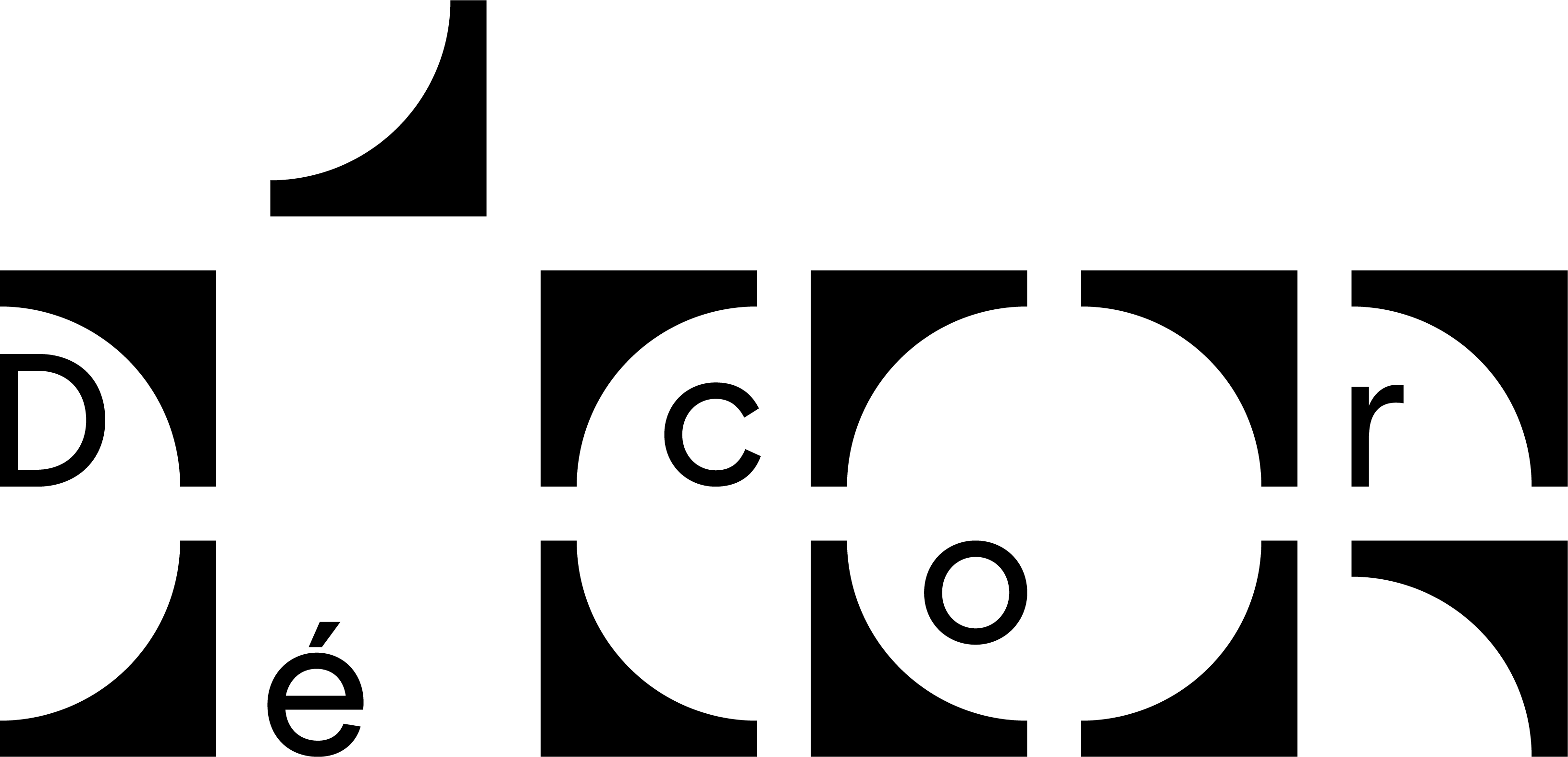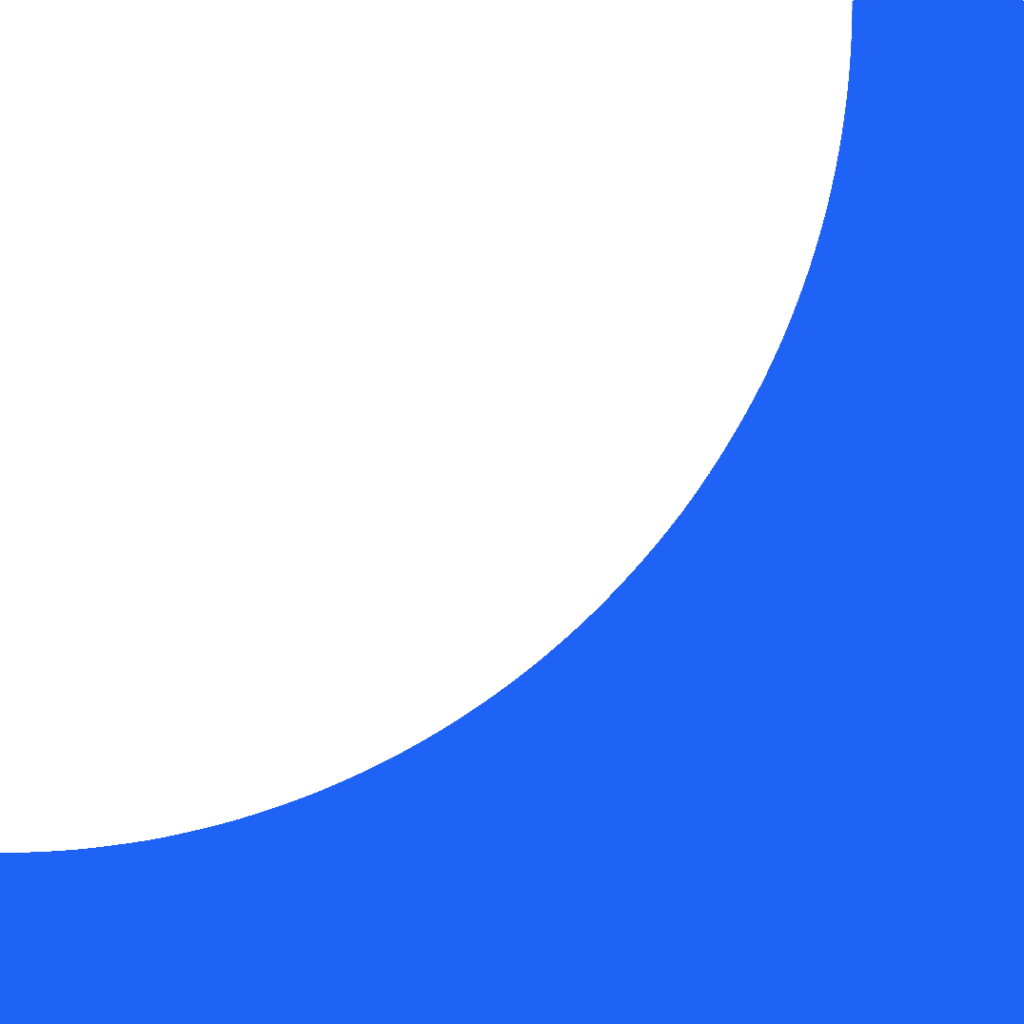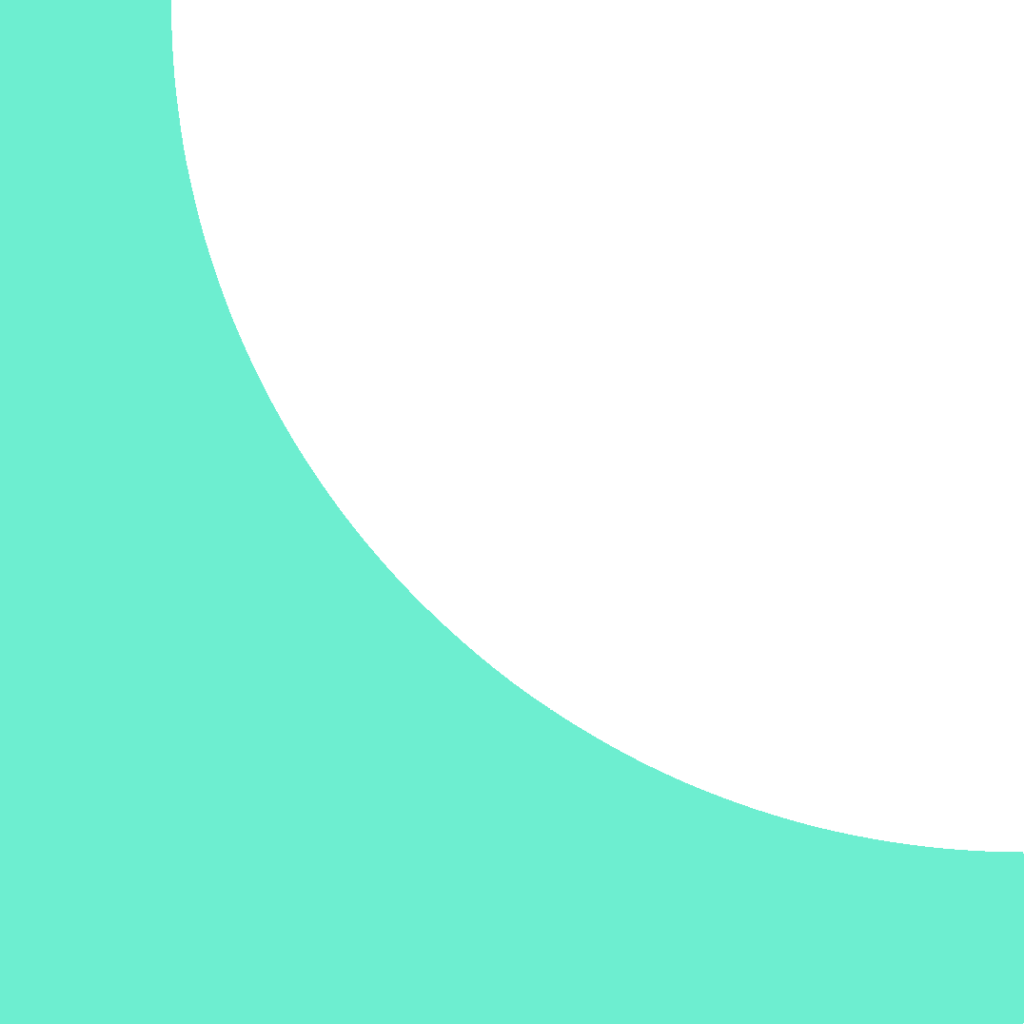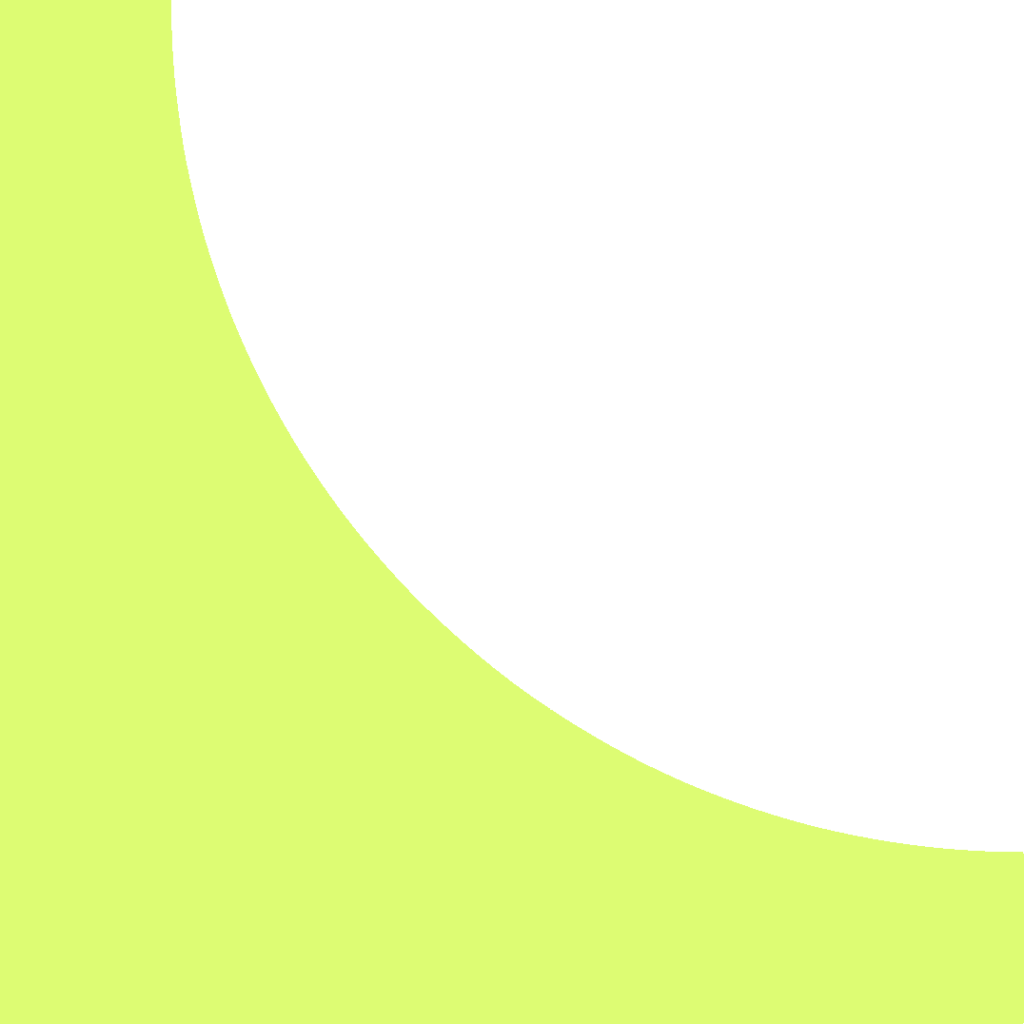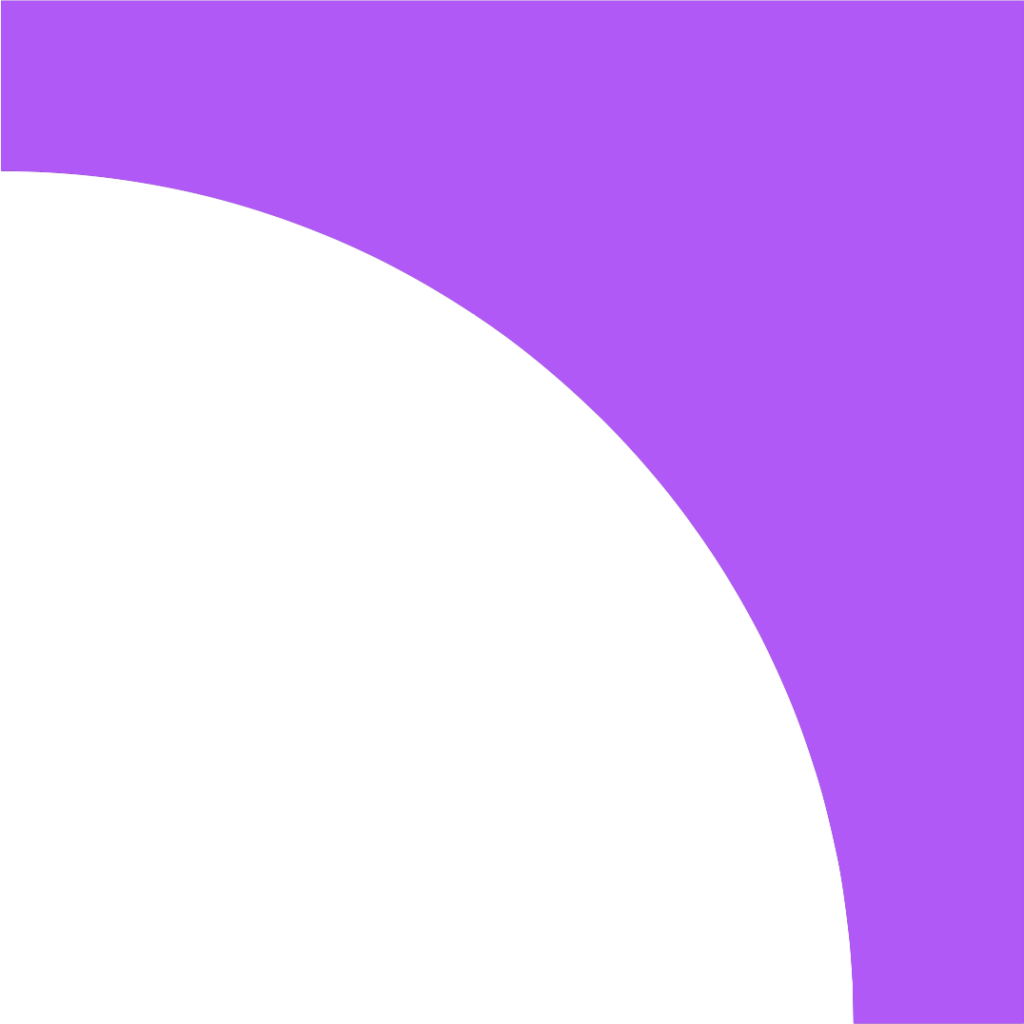Qu’entend-on depuis quelques années, à la campagne, en ville, à droite et à gauche, se répandant partout comme la trainée de poudre d’un boute-feu ? Quel est ce tic verbal répété mécaniquement par nos enfants et par nous-mêmes, sans lequel aucune parole ne paraît capable d’être prise, sans lequel aucun argument ne semble avoir dorénavant prise ? Quel est donc ce passe-partout langagier, ce couteau suisse d’orateur dépressif ? Un banal vulgarisme syntaxique : du coup !
Du coup : l’annonce, l’amorce d’un énoncé lié par causalité à celui qui précède, imposant l’enchaînement logique d’un supposé conséquent à un antécédent. « Du coup je voulais faire… », « du coup j’ai pensé à… », du coup par-ci, du coup par-là…
La contagion virale qui a répandu en quelques années l’usage spectaculaire de cette formule (je n’ai pas de chiffres statistiques à vous présenter, aussi vous prierais-je de bien vouloir me croire) traduit sa haute faculté de transmission, et son adéquation à une forme de pensée largement partagée. Ses usagers en apprécient la facilité d’emploi, versatile, tout-terrain, offrant tout à la fois un appui appréciable au locuteur à court d’idée et l’apparence d’une pensée construite par la logique. Et comme tous les tics verbaux, il agit comme un gri-gri, aussitôt essayé aussitôt adopté : très vite, il est répété avec compulsion à l’insu de son chamane. Son enjeu paraît bien mince, mais sa large diffusion nous dit quelque chose de nous et de nos craintes. Mais parlons ici des « victimes » les plus atteintes, non celles qui par négligence n’ont qu’oublié les donc et les alors, mais celles qui, prisonnières dépendantes d’un mode de communication rudimentaire, peuvent enchaîner plus de dix du coup à la minute (cadence dûment relevée).
Car derrière ce qui apparaît de prime abord comme une inconsciente et quelque peu ridicule facilité de langage, à laquelle on succombe par paresse et dont on peut sourire — que celui qui n’a jamais péché jette la première pierre ! — se dissimule un petit, mais remarquable, symptôme sociétal : du coup, c’est le besoin subliminal de justifier son discours, la parade naïve à la peur panique d’une faiblesse de raisonnement, d’une incohérence coupable qui appellerait une imparable réfutation. Il faut donc « bétonner » ! Ainsi, articuler chaque segment de phrase, chaque bout d’idée avec un du coup machinal, nonchalant ou persuasif, confère au locuteur la certitude imaginaire de n’avoir rien à craindre dans sa prise de parole. Grâce à la formule magique répétée en tant que de besoin, toute éventuelle critique d’incohérence semble stérilisée, annihilée, anéantie au fur et à mesure de la progression du discours. Ce dernier sort alors de la bouche du locuteur comme un pilier en béton armé jusqu’aux dents, insécable, inexorable, irréfutable. Du coup, du coup, du coup… Ne faut-il pas tristement manquer de confiance en soi ? Ne faut-il pas avoir peur, mort de trouille, pour répéter ce mantra, lèvres agitées comme un poisson sorti de l’eau, irresponsable et impuissant ?
Ce du coup procède de deux aveuglements :
1) D’abord, la revendication indue d’une logique causale. Une attraction subliminale agit derrière ce tic, la recherche de la Cause, qui est consubstantielle à notre civilisation scientifique. La métaphysique grecque, en particulier avec Aristote, lui attribue une large place opératoire, aussi bien en physique qu’en théologie. Ainsi, la recherche et la découverte de la Cause Première, première de toutes les causes, nous fait toucher l’ordre premier de l’univers, et nous fait accéder à Dieu. Wikipedia cite l’auteur néerlandais Willem Jacob Verdenius : Ce Premier Moteur, le Dieu aristotélicien, est source ultime du bien : « Il cause l’ordre du monde, premièrement à titre d’objet du désir du monde, mais en second lieu comme une source régulatrice. » Cette Cause Première est donc le dénominateur commun à toute chose, certitude logique qui a permis à la scolastique médiévale de réconcilier le concept aristotélicien avec le christianisme. S’appuyant sur cette fondation inexpugnable, il est alors possible de redescendre toutes les conséquences successives, suivant étape par étape une hiérarchie causale fondatrice de toute science, jusqu’aux conséquences dernières. Du coup peut ainsi devenir un mantra protecteur, par lequel tout le discours est maintenu corseté dans une pseudo-logique indéboulonnable.
Bien entendu, on ne peut faire grief aux innombrables victimes de cette contagion langagière de méconnaître sa généalogie philosophique. Et l’on pourrait n’accorder que peu d’importance à ce qui semble n’être qu’une scorie négligeable, une écume sans substance. Peut-être l’auteur de ces lignes surinterprète-t-il la futilité, mais le succès d’un tic verbal n’exprime-t-il pas un symptôme de l’époque ? Les mots conservent leur sens, et ici les termes du discours s’articulent selon une étrange pseudo-logique. Car voilà devant nous une triste perspective : un carcan de causalités non démontrées, par lesquelles tout énoncé porte en lui-même sa propre preuve, assène sa propre justification. Langue de bois, bouche close, enfermée… Contrairement aux laboratoires de physique ou de mécanique, où les lois de causalité s’appliquent selon des modèles mathématiques, la psyché humaine n’admet pas le protocole de l’expérience reproductible — hormis dans quelques laboratoires de psychologie expérimentale — en raison de la profondeur spirituelle et culturelle de chaque individu, cette insondable richesse que confèrent à la vie l’attrait de l’inconnu et le champ des possibles. Pour notre plus grand bien, les lois de l’amour et de l’amitié échappent aux équations, aux démonstrations sur tableau noir et aux bilans prévisionnels. Dès lors, appliquer coûte que coûte une inflexible logique causale à nos raisonnements humains génère une anthropologie instrumentale et négative, dégradant ipso facto la matière humaine en un « matériau » pondérable. Matière première, matière dernière…
Ainsi dans le champ politique, scientifique, artistique même, d’affreuses certitudes sont parfois débitées avec l’assurance viciée de ne pas se tromper grâce à l’énoncé de causes explicatives. Telle par exemple cette manie de certains films de justifier les actions de leurs personnages par de pesants et inutiles argumentaires psychologiques, comme s’il fallait assurer et rassurer le spectateur que tout ce qui arrive dans le scénario est absolument explicable… Et les justifications ampoulées ou maladroites imprimées sur le livret remis à chaque spectateur du moindre spectacle ont-elles parfois cette mission : expliquer la cohérence d’une création en faisant paravent à toute critique éventuelle. Car tenu de fournir ses explications selon une convention morale de l’époque — surplombante et bien-pensante, intériorisée en autocensure par l’auteur pusillanime — ce dernier pense pouvoir parer doutes et critiques en ayant l’assurance de répondre à la question fatale : « pourquoi ? ». Allégeant le fardeau de la responsabilité de l’auteur, ce besoin de l’explication — comme autant de du coup parsemant son œuvre avec opportunisme — ne court-il pas le risque de cantonner l’expression artistique à une démonstration pseudo-logique1 ? Cette irruption morale de la causalité au sein des représentations de notre époque traduit aussi une crise de la responsabilité, de l’autorité. Voilà bien l’antithèse désastreuse de toute poésie, l’anti–rhizome : l’art ne nous invite pas à une démonstration convenue mais à un surgissement inconvenant.
C’est ici la seconde duperie de ces du coup intempestifs, contrecoup de la première :
2) Le rabattement d’une logique utilitariste sur l’esthétique. Tout événement, en tant qu’irruption-disruption d’un phénomène qui advient devant nous, ne peut qu’échapper à nos tentatives rationnelles de généalogie. Par définition, pourrait-on dire : un événement échappe à toute causalité. François Jullien, aussi fin connaisseur des Grecs que des Chinois, l’a formulé ainsi : « Les Grecs, eux, du moins à partir du développement de la métaphysique, n’ont pu accorder de statut fiable à l’événement : d’une part, parce que le devenir, en manque d’identité (d’« être »), n’est que corruption dans son métabolisme ; et, que d’autre part, parce qu’ils sont attachés à l’explication, c’est-à-dire à la liaison causale (l’aitia) et que, dans la logique de la causation, il n’y a pas d’événement, à proprement parler, mais seulement des effets procédant des causes2. »
Ne tombons pas dans le travers futile d’assimiler explication avec logique. Tout authentique événement artistique possède sa logique interne, c’est même le privilège du créateur d’en révéler les formes, les couleurs, les sons et les arômes ! Et comme on l’a vu, rapporter à la compréhension sagace du public la nécessité d’une explication pour apprécier son œuvre constitue un abaissement dommageable de sa part — laissons cette tâche aux critiques. Mais, par les biais d’une pensée craintive ou naïve, la maladroite grossièreté confondant coïncidence avec causalité ne risque-t-elle pas en retour d’appliquer sur l’œuvre elle-même les méfaits mécanistes de trop commodes causalités, générant par exemple des temporalités linéaires en dominos ? Et d’exclure de la création les formes « polyphoniques » superposant des figures coïncidentes mais non corrélées ? Voire, et cela serait plus grave, conduire à la négation fatale de la beauté de l’imprévu, de l’accident fécond, de l’inconnaissable destin qui nous attend ? Et, sous les coups portés par des du coup insensés, vacillerait alors et s’abattrait enfin le sens-même du Tragique — le fatum — la poutre maîtresse de toutes nos dramaturgies ?
Mais il y a plus de deux mille cinq cents ans, les Chinois ont découvert un antidote, le taoïsme, dont la philosophie maintient avec sagesse et prudence l’individu à égale distance du Ciel et de la Terre. Ainsi cette classique parabole sur l’insondable réalité : au nord du pays, un vieux élevait des chevaux, et un en particulier depuis sa naissance. Mais un jour, celui-ci disparut au-delà de la frontière. La nouvelle connue, les voisins vinrent rendre visite au vieil homme, déplorant sa malchance. Lui ne se plaignait pas : « Pourquoi ne serait-ce pas une bénédiction ? » Mais quelques mois après, le cheval revint à la maison accompagné d’un étalon sauvage. Alors que ses voisins le félicitaient, le vieux maugréa : « Pourquoi ne serait-ce pas un désastre ? » Et son fils s’empressa alors d’aller dompter l’étalon. Mal lui en prit, il tomba et se cassa les deux jambes. Les voisins compatissants furent surpris par le détachement du père. Survint une guerre. Tous les jeunes gens valides furent enrôlés dans l’armée, mais très peu revinrent sains et saufs. Le vieux, lui, était resté en sécurité avec son fils boiteux. Et les voisins pensèrent à ses paroles, « la bénédiction est un désastre et le malheur est une bénédiction3. » Ainsi le Yin et le Yang : à l’intérieur de l’un, il y a la présence de l’autre.
La prétention humaine à la connaissance, si admirable et élevée soit-elle, ne peut aller sans sa face obscure, et il y a parfois dans les sciences, les arts ou la politique d’épouvantables puanteurs d’apothicaire. Celles-ci méritent de sévères purges, quand les victimes du ridicule d’un tic n’appellent qu’indulgence. Mais si les formes les plus triviales de l’esprit ne manquent hélas pas, l’une de ses formes les plus subtiles consiste à accueillir l’existence d’effets sans cause identifiable, à accepter l’abandon confiant, et à reconnaître, par la force infiniment inspirante de la poésie, la douce légèreté de l’inconnaissable, de l’injustifiable, de l’injustifié. L’essence même du Tragique : le sens de toute révélation ne peut qu’être dissimulé à nos regards.
– Mais pourquoi, du coup ?
– Parce que c’est ainsi…