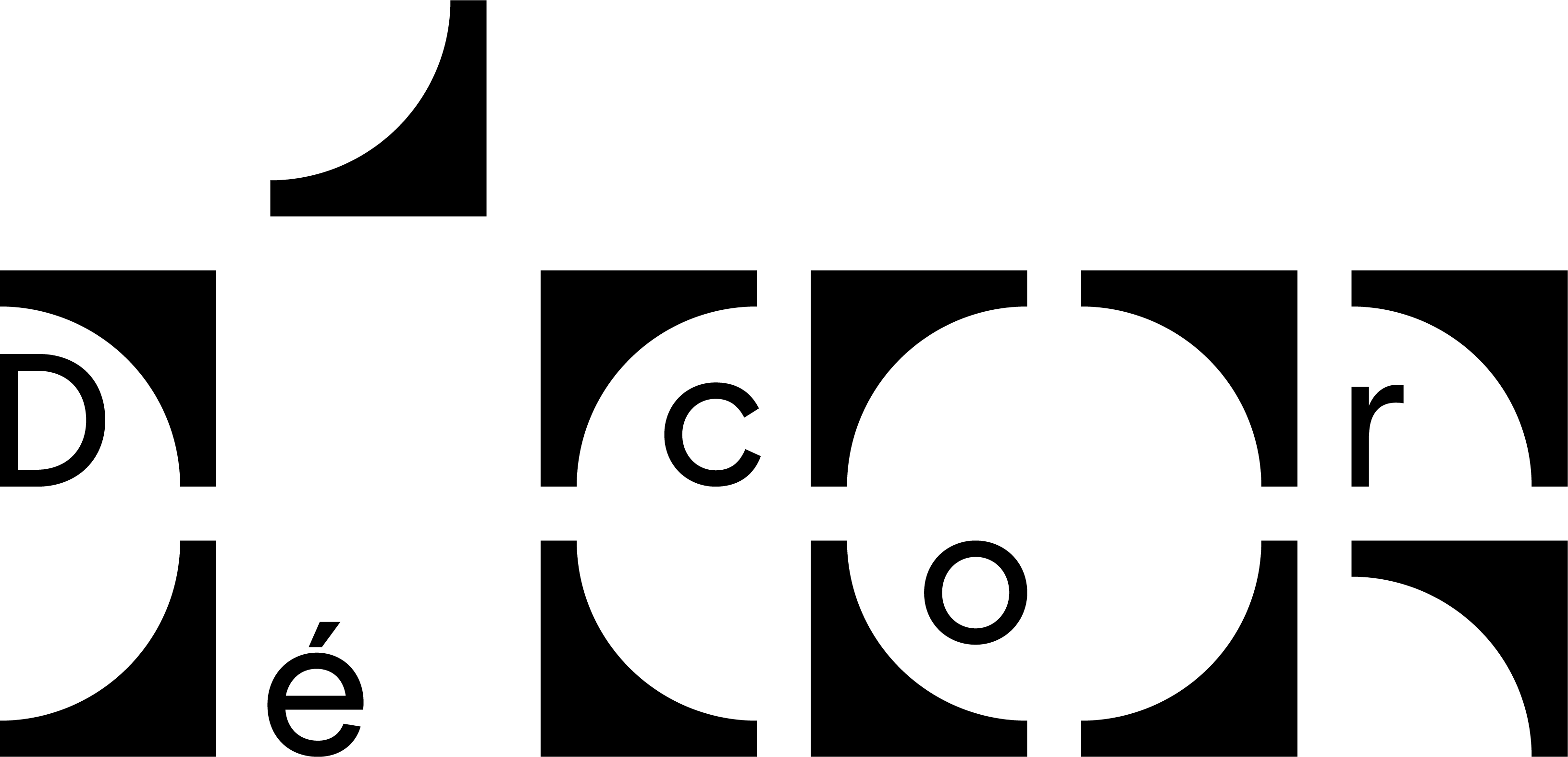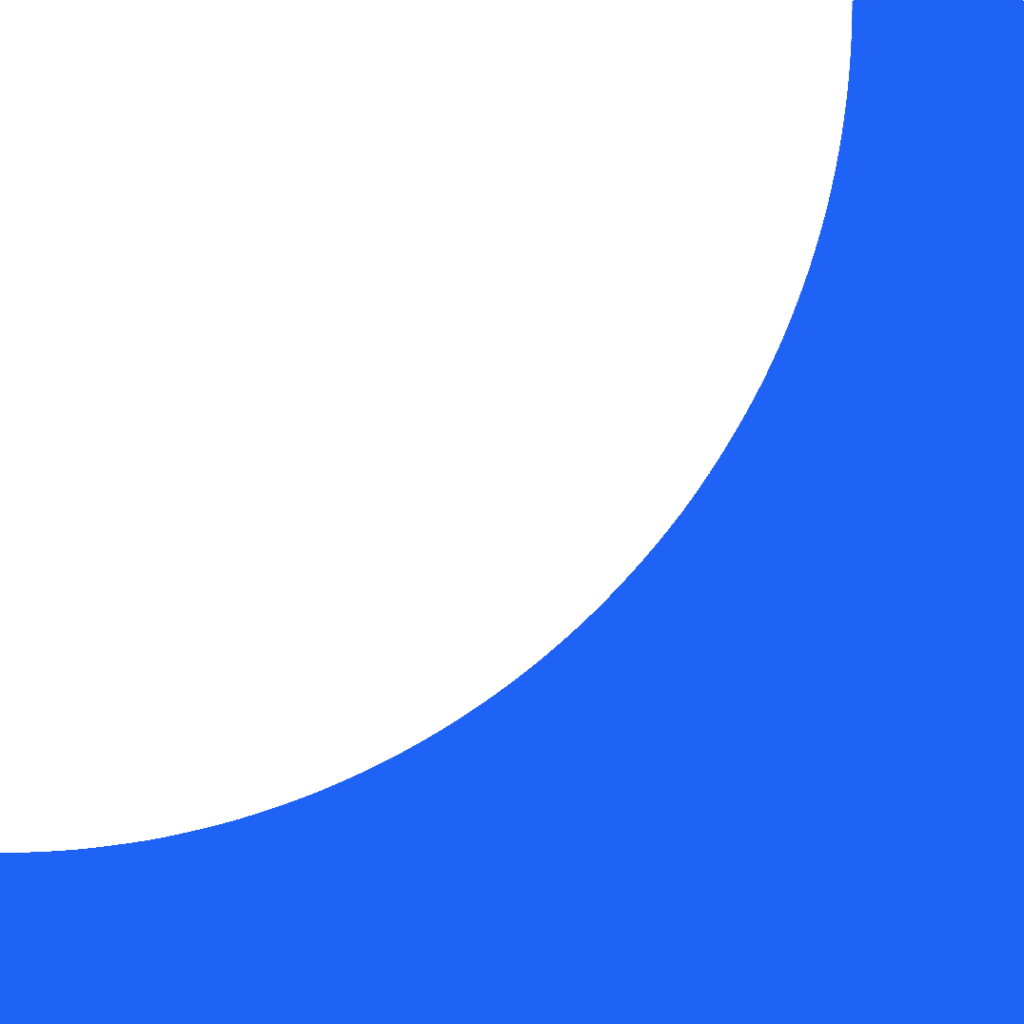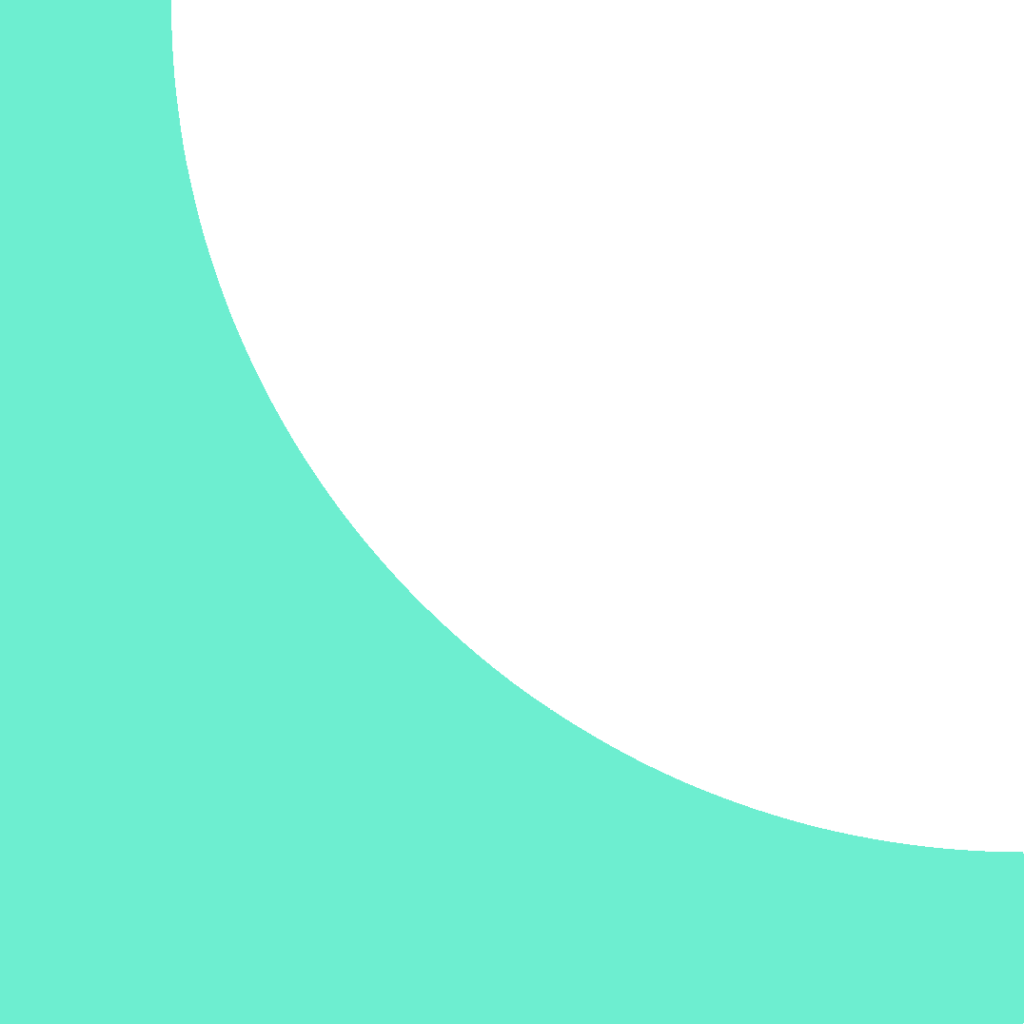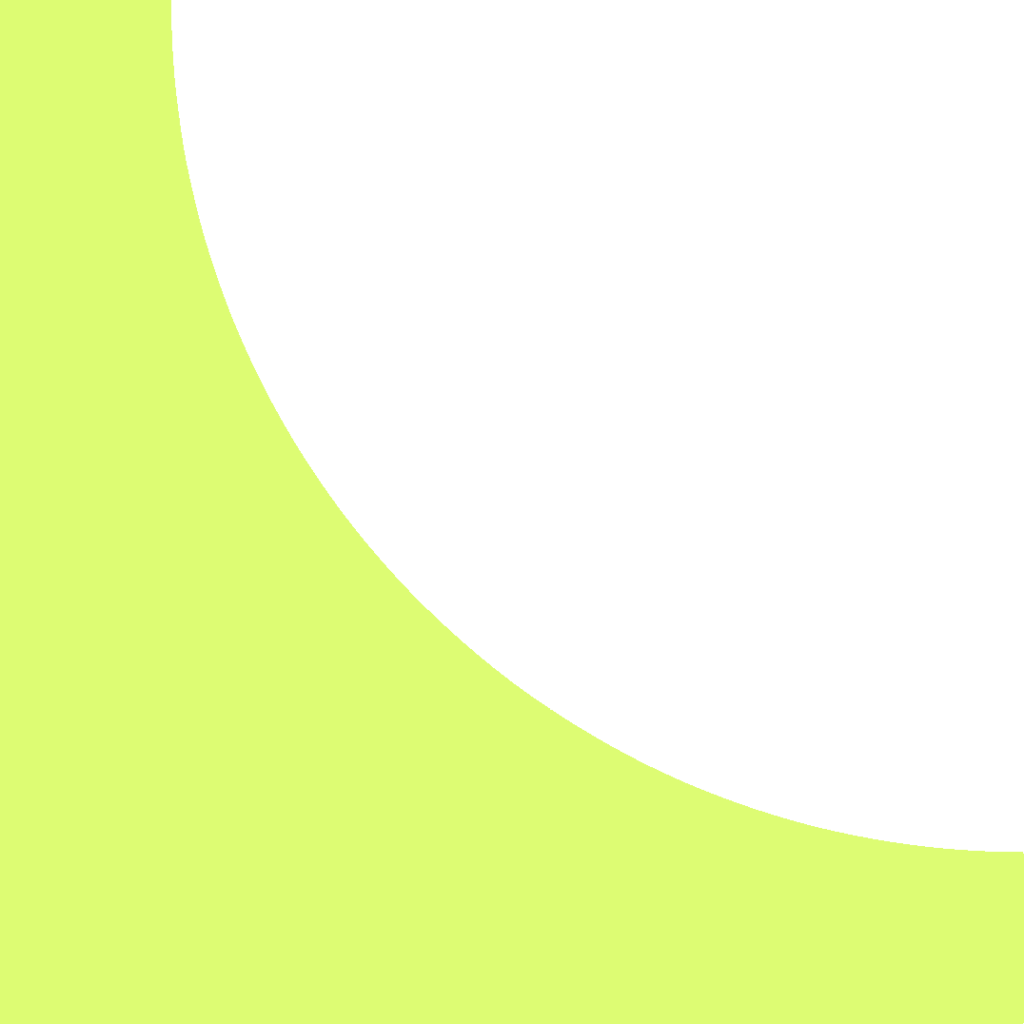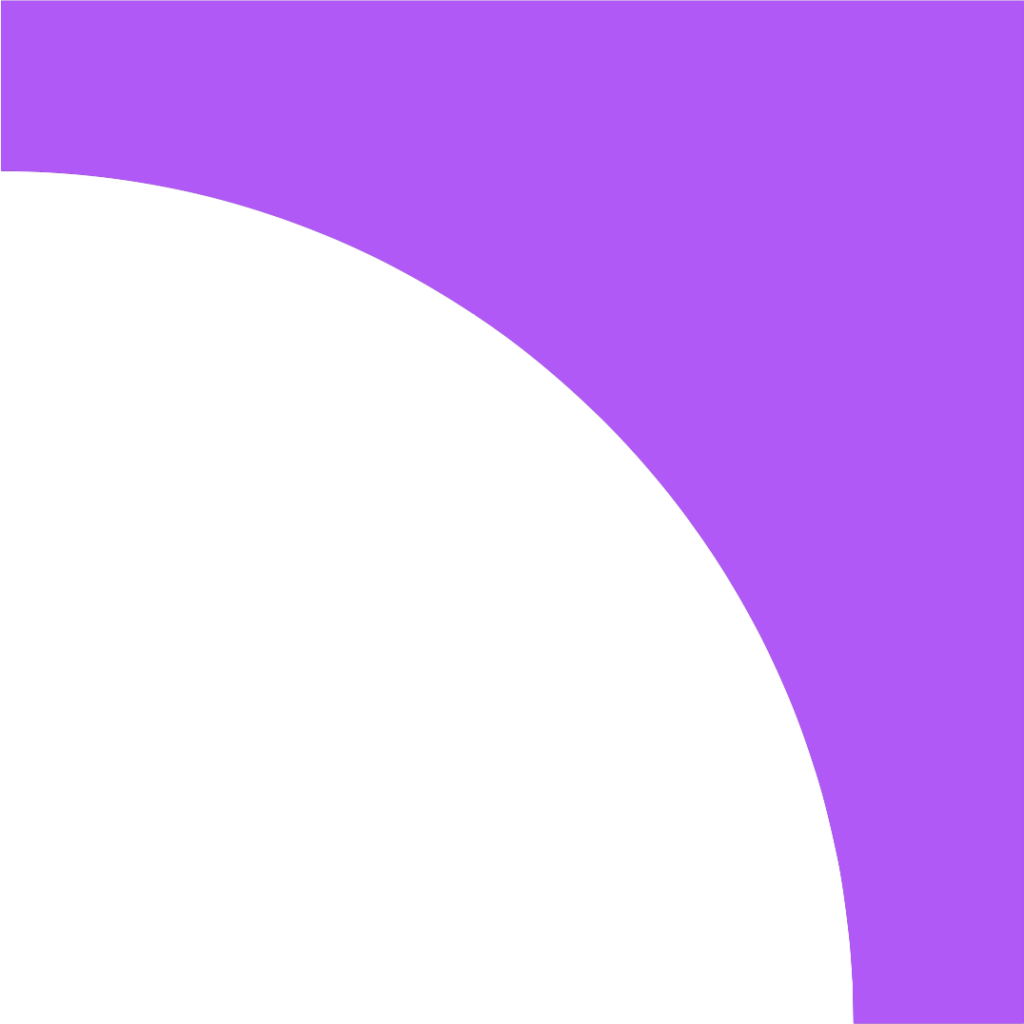Armand Morin, Je ne suis pas là, je m’enlève (2018, 31′). Documentaire avec Carlos Kusnir, Julie Crenn et Claude Lévêque.
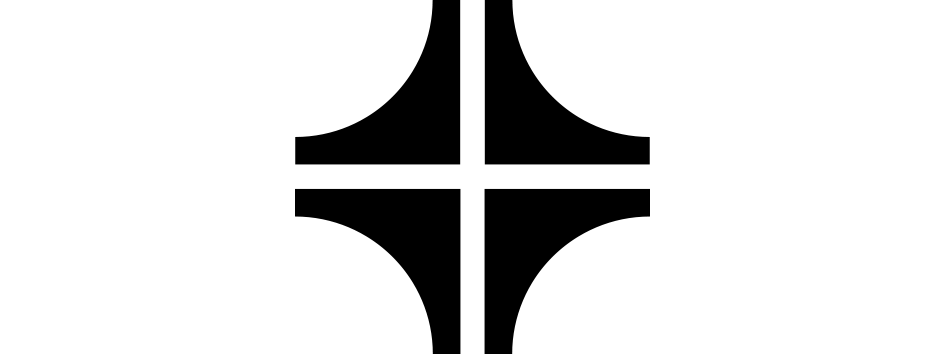
Carlos Kusnir Les façades que j’ai montrées dehors sont des formes sans fond qui se mélangent au paysage. Elles sont forcées, condamnées à dialoguer avec le paysage.
Pierre Mabille Elles s’imposent avec la même brutalité qu’un panneau publicitaire mais c’est un dialogue très différent qui s’engage. Je trouve qu’elles transforment les lieux en paysages. On le voit bien sur les photographies : le paysage apparaît d’une manière étonnante, pas par le recours au cadrage comme on l’a souvent vu ailleurs, mais par incrustation de ces grandes images découpées, fragments de parois animées de motifs décoratifs plus ou moins continus et accidentés. Ce nouveau paysage est assez inhabituel dans ses rapports d’échelles et de couleurs. On regarde ces façades en passant ou de manière frontale, on peut aussi aller derrière, vérifier « l’envers du décor » : d’ailleurs on découvre que c’est fabriqué comme un décor de théâtre. Un lieu sans qualité au départ devient une scène, le paysage se transforme en décor.
CK : Je voyais jusqu’ici les changements qui pouvaient s’opérer dans les « façades » selon le point de vue du regardeur. Mais là tu présentes des changements qui pourraient s’introduire dans le paysage grâce à la présence des façades. C’est nouveau pour moi.
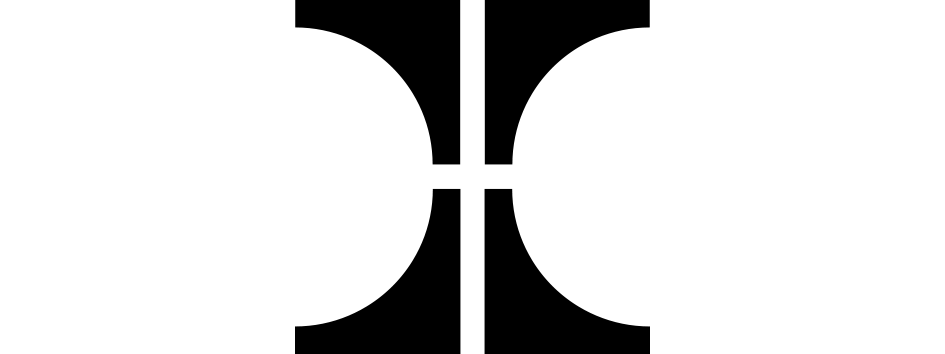
CK : Je dis souvent que, pour moi, une peinture est terminée quand elle commence à nous regarder.
PM : Oui, ces tableaux sont habillés ou costumés ou déguisés, ce sont des individus, presque des personnages, ils ont même parfois une présence organique (des poils, des cheveux, la surface picturale d’un épiderme accidenté, avec plis, rides, etc.). On a une difficulté à les analyser ou à les contempler. C’est un peu comme si de leur côté ils avaient travaillé leur apparence pour entrer en relation avec nous. A la fois tableaux et amorces de personnes, ils nous obligent à porter sur eux un regard inhabituel. C’est une rencontre insolite.
CK : C’est un dialogue qui s’installe entre l’objet et la peinture. Un jeu de rebondissements qui me sert à créer une dynamique dans le faire. Et puis, il y a l’histoire de la présence, une peinture en tant que présence… comme si j’avais besoin de donner au travail un statut existentiel. C’est physique. Je me dis souvent (et peut-être à tort) qu’autrefois, la peinture était reliée à des situations de vie. Physiquement elle faisait partie d’un meuble, d’une architecture, ou d’un objet (je pense aux églises, aux fresques, aux enluminures, aux paravents, aux retables). Et qu’après l’invention du tableau, nous avons gagné en indépendance, mais perdu ce lien. Mes grandes peintures sont souvent « au sol », elles sont comme des lieux. Mais des lieux autonomes et inventés de toutes pièces. Peut-être que c’est pour cela qu’on pense au décor, qu’on pense à quelque chose qui accompagne. Quand on pense « décor » on pense immédiatement à « espace », et on pense aussi un lieu et un environnement dans lesquels se passe (ou s’est passée) une action. Sauf que là, le lieu et l’action sont purement imaginaires. Et que parfois, chez moi, l’action est simplement réduite à ce qui m’arrive à moi et à cette peinture qui est à côté de moi en train de se faire.
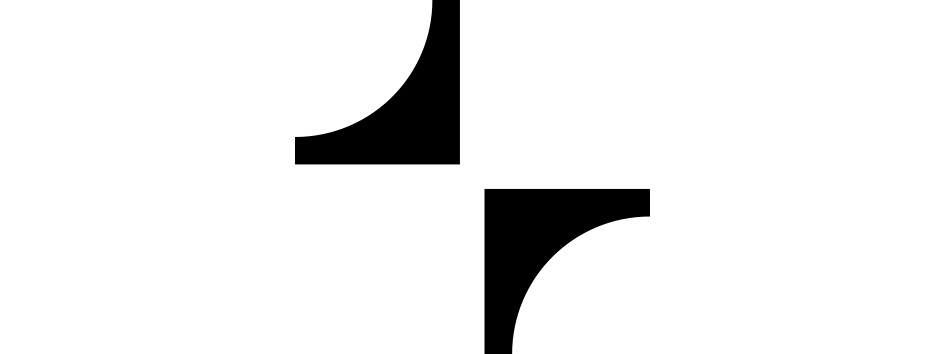
PM : Souvent il y a l’idée d’une scène, ou au moins d’un événement. Au Garage Cosmos de Bruxelles, dans la salle où il y a ces trois grandes pièces, on a cette première impression : il s’est passé quelque chose. C’est toujours un peu bordélique, on se trouve dans un espace provisoire, non fini, non rangé, un espace en dérangement, bancal, tout apparaît interrompu dans un mouvement, comme laissé en plan. Une forme de désordre domestique, d’instabilité. Ce qu’on voit est à la fois la fabrique et le résultat, le tableau et son processus, l’atelier est compris dans le tableau. Cette idée d’une peinture jamais finie est un aspect qui me passionne : c’est ce que j’aime également chez un des mes peintres préférés, Pierre Bonnard.
CK : Tu as lu le texte « Du hasard dans la production artistique » d’August Strindberg ? Il parle du caractère indéterminé des images. Je fais beaucoup d’esquisses préparatoires avant de me lancer dans une peinture, mais il ne s’agit jamais de reproduire une image. Cette impression que tu as de « l’atelier compris dans le tableau », elle vient peut-être du fait qu’il faut que quelque chose se passe de nouveau entre moi et la peinture pendant la réalisation.
PM : La première fois que j’ai ressenti ça, c’était avec ce grand tableau sur lequel est écrit « Je suis au café ». L’expérience de vivre un moment particulier, quelque chose arrêté dans un récit, on ne sait pas si c’est fini ou si la situation peut encore changer. Comment est fabriqué cet ajustement de matériaux d’images et de gestes, comment sont intégrés les vrais et faux accidents, comment se construisent les rimes visuelles… Ça produit chez moi la vision imaginaire d’un atelier dans lequel on vit avec les outils et supports classiques de la peinture mêlés aux objets et aux images collectés dans la rue. Mixé aussi avec la cuisine, le ménage, la famille, les amis, les projets, la lessive, les voisins, la radio, les souvenirs… bref avec la vie de tous les jours. Dans tes expositions il y a aussi des boucles de musiques populaires qui soudain se manifestent, des poules vivantes, toutes sortes d’importations du dehors qui construisent cette situation particulière. Ce qui donne le vertige, c’est qu’on sait simultanément que ce moment est mis en scène.
CK : La mise en scène, ça se fabrique. La spontanéité je n’y crois pas trop. J’ai remarqué que les gens qui parlent de spontanéité font souvent la même chose. Avec Frédéric Valabrègue, nous parlons de la différence entre spontanéité et improvisation. Frédéric dit que l’improvisation c’est quand quelqu’un vient avec ses provisions. On construit des rapports entre les choses, les unes avec les autres.
PM : C’est presque un rapport d’égalité entre les images, les ornements banals, des signes tabous, des mots, des objets et des sons… tous ces éléments sont utilisés sans hiérarchie. Parfois dans une même pièce les objets sont intégrés comme dans un collage et simultanément représentés comme dans un trompe-l’œil : meubles, sièges, outils de ménage (seaux, balais, bassines, …) table et fers à repasser, cordes et pinces à linge, … De la même façon les motifs décoratifs deviennent éléments volumiques, et des figures se répètent comme se répètent les motifs décoratifs : la figure du rideau (de théâtre ou de fenêtre), les balais (parfois considérés comme de grands pinceaux) de différentes formes, les ventouses à déboucher, les représentations d’animaux domestiques, les fruits, … tous acteurs et figurants dans un même décor de scène.
CK : La polyphonie, l’hétérogénéité, c’est quelque chose de naturel chez moi. Et puis cela met en évidence la relativité de toute chose. Ensuite vient le phénomène de la « monstration » : Il s’agit d’inventer un rapport entre des pièces autonomes afin de créer un événement en soi. Construire un « grand tableau » avec de « petits tableaux » m’a souvent conduit à faire appel à des pièces sans tenir le moindre compte de la chronologie : il m’est arrivé une fois d’utiliser une gouache que j’avais faite quand j’avais 9 ans.
PM : D’abord une phase d’esquisses, avec beaucoup de dessins qui préfigurent les peintures et les espaces puis une deuxième phase de monstration, qui construit un événement en soi. Ces deux phases constituent-elles ta méthode de travail ?
CK : Je ne crois pas que ce soit une méthode en tant que telle, mais si je regarde en arrière, je vois plutôt trois moments : le moment où je fais les esquisses ou planches préparatoires ; le moment où je me lance dans la peinture ; et – bien plus tard – le moment de l’exposition, qui, pour moi, est une étape indépendante, car je ne pense pas à la monstration dans les deux premiers moments. L’exposition c’est le moment de la combinatoire entre des pièces qui sont déjà faites.
PM : … des Combine Paintings ?
CK : Récemment, une amie m’a parlé aussi des Combine Paintings de Rauschenberg, et je lui disais que oui. Mais que sans une charge émotionnelle, je ne pourrais pas faire. Disons que je m’implique dans ce jeu de combinatoires.
PM : En comparaison, la présence « matérielle » de ta peinture apparaît plus légère et plus classique, reliée à une tradition réaliste : moins d’épaisseur, couches picturales fines, transparences des teintes, modelés. Même les accidents comme les taches ou les coulures s’intègrent dans le même climat coloré. Et on reconnaît une palette qui est la tienne. Il y a un contraste entre la turbulence des compositions et une couleur qui joue dans une lumière homogène plutôt douce (parfois presque une grisaille). Tes gris colorés et tes couleurs atténuées donnent le sentiment d’une décoloration, de surfaces usées, désaturées. On peut dire aussi des couleurs passées.
CK : Dans les couleurs, je travaille beaucoup le rapport entre neutres et saturés. Un va-et-vient. Il y a un chapitre dédié à Van Gogh dans le Traité du Paysage d’André Lothe qui m’a beaucoup marqué. Tu peux faire l’expérience en faisant un petit trou dans un papier blanc : tu parcours un paysage de Van Gogh, et tu découvres qu’il introduit très rarement une couleur saturée, pure. Et que si elle est présente et qu’elle pète tellement, c’est justement parce qu’elle est entourée de couleurs neutres.
PM : Dans le film documentaire réalisé par Armand Morin, Claude Lévêque dit que tu es plus décoratif que lui, et tu réponds « Je t’en prie ! » en riant. On pourrait aussi bien affirmer l’inverse… puis il précise que si tu étais décorateur tu serais « décorateur d’intérieur », alors que lui serait plutôt un « décorateur de discothèque »…
CK : C’était une boutade par rapport à la question sur le décoratif. Tu peux bien penser ce que tu veux.