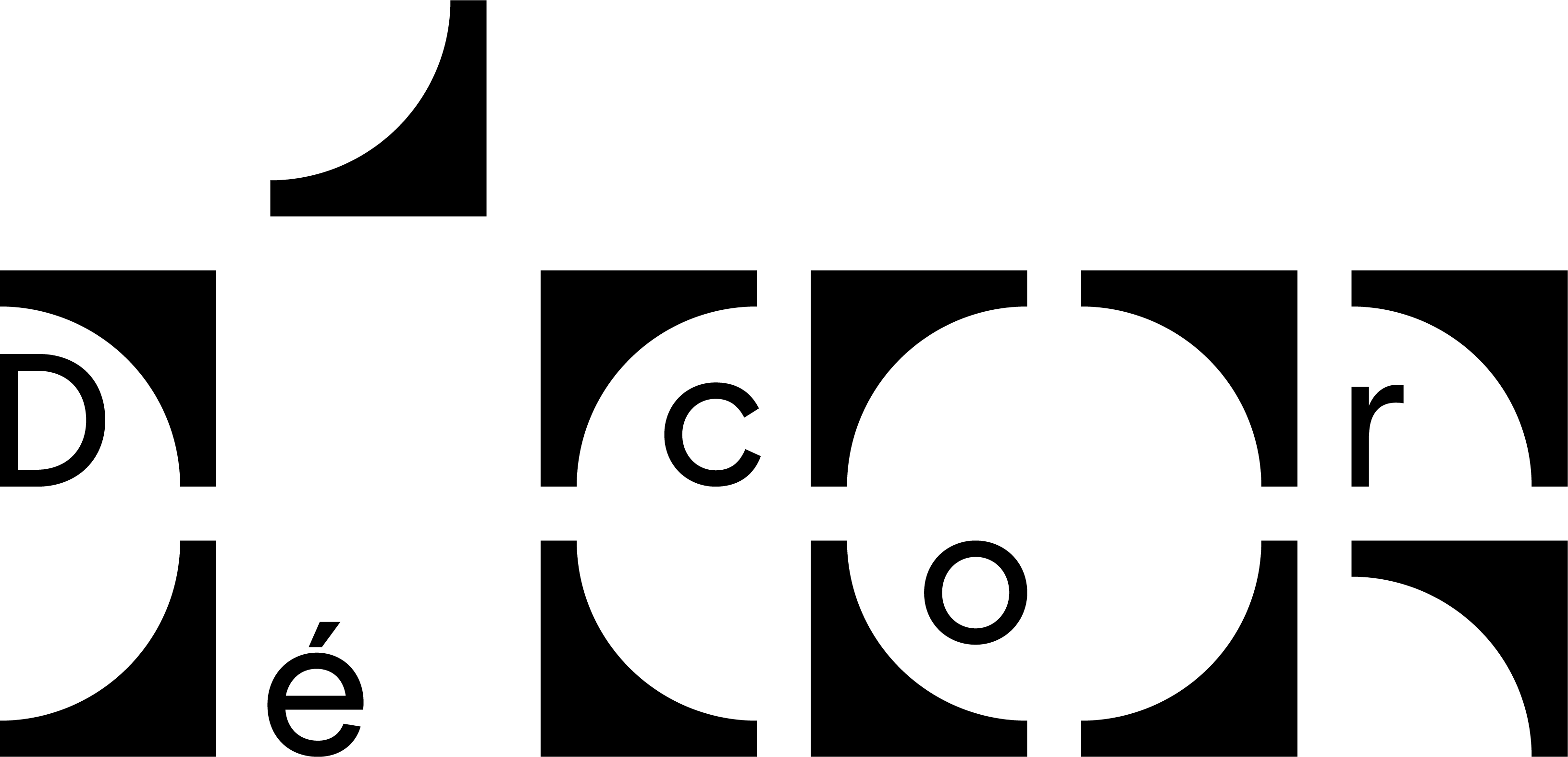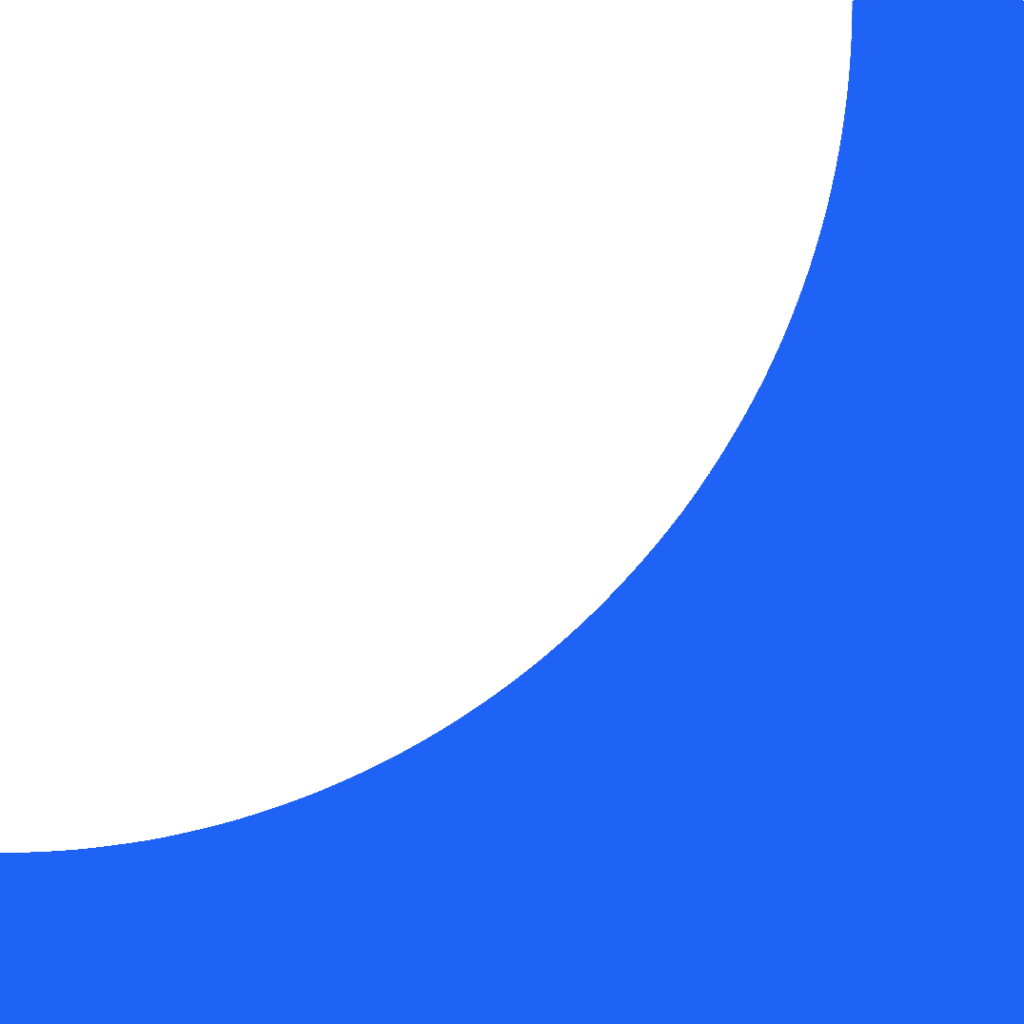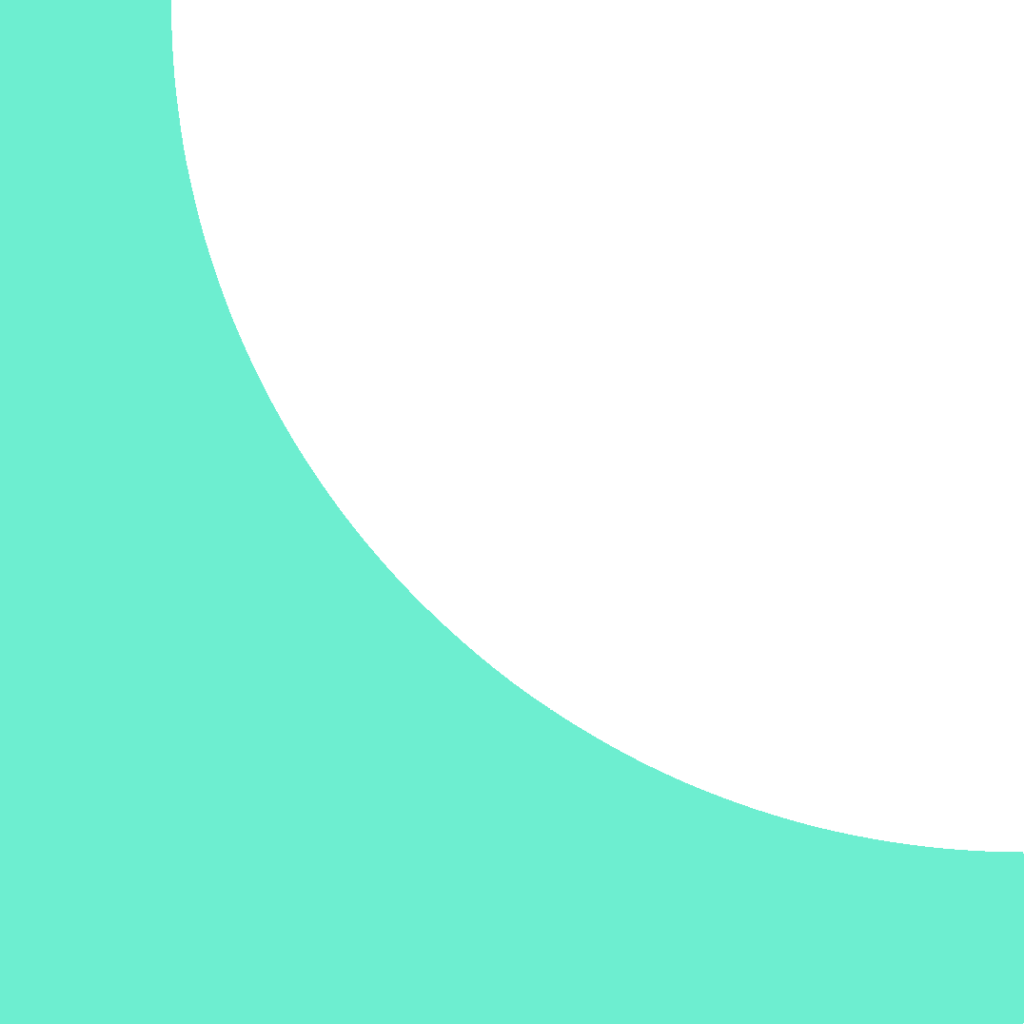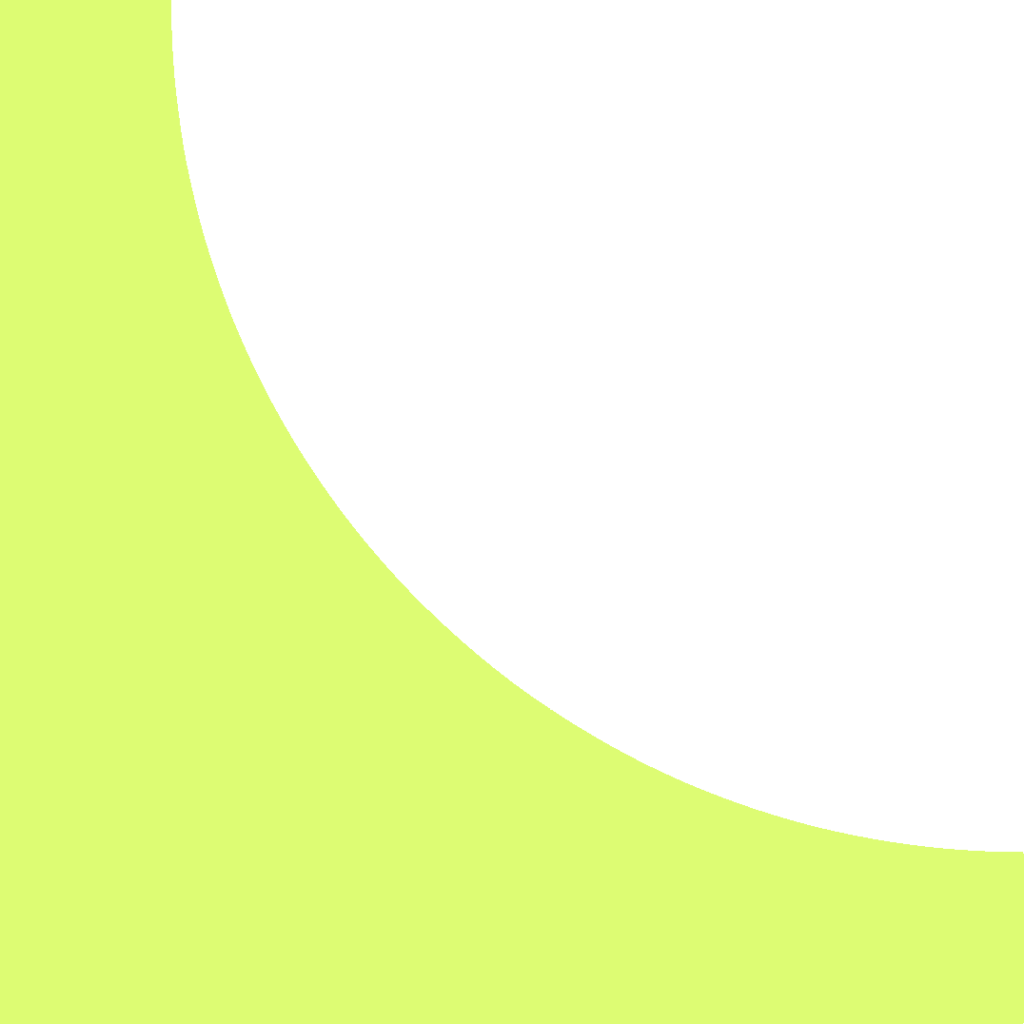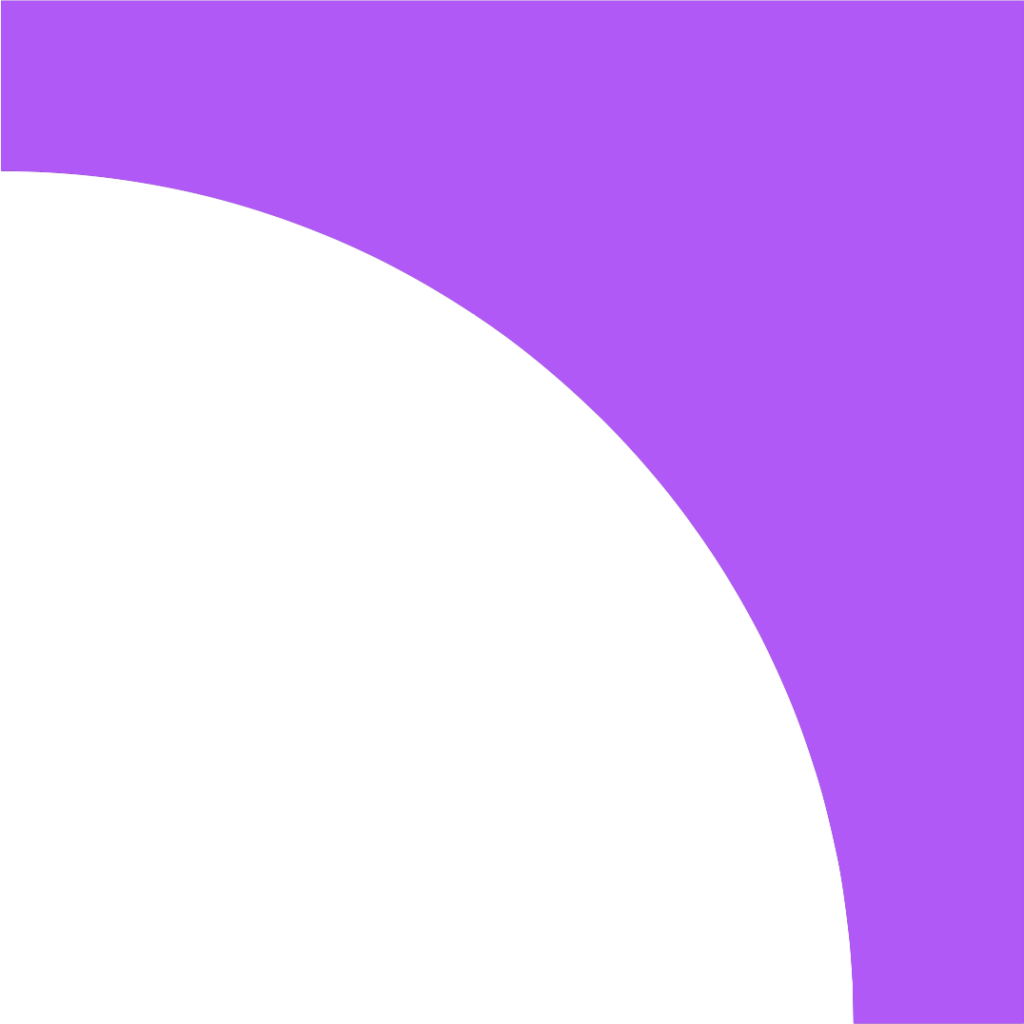J’ai vu l’avenir. Il était vide.
Propre et plat, planifié de bout en bout.
Dans son film How to Kill People (1963), le designer George Nelson explique que l’assassinat est affaire de design, à côté de la mode et des tâches ménagères. En effet, le design est décisif pour améliorer à la fois la forme et le fonctionnement des armes, en déployant une esthétique au service des technologies létales.

Cette ville a servi de cobaye à une version accélérée du design* de la mort. Elle a été presque totalement annihilée, les gens ont été expropriés. Les jeunes ont mené une insurrection pour réclamer l’autonomie. Mais la violence de l’Etat l’a massivement écrasée : réquisition des bâtiments, destruction des quartiers, on a étranglé le mouvement et avec lui les espoirs de décentralisation, de sécularisation et d’égalité. D’autres villes ont connu pire. Il y a eu beaucoup de morts. Ailleurs, les opérations se poursuivent.
Non, cette ville n’est pas en Syrie. Ni en Irak. Appelons-la pour l’instant « la vieille ville ». Les monuments de cette région remontent à l’âge de pierre. Ici, le design futur de la mort est déjà à l’œuvre.
Il est accélérationniste, il articule logiciels et matériel informatique, il combine messages d’urgence, programmes, formulaires et modèles. Les tanks se coordonnent avec les bases de données, les armes chimiques croisent les pelleteuses, les médias sociaux vont avec les gaz lacrymo, les différentes langues, les forces spéciales et les stratégies de marque.
Dans la rue, des enfants jouaient avec un vieux clavier d’ordinateur abandonné sur une pile de gravats et de saletés. Dessus, il y avait écrit « Fun City » en grosses lettres rouges. Au XIIᵉ siècle, un des grands précurseurs de l’informatique et de la cybernétique a vécu dans cette vieille ville. Ce savant, Al-Jazari, a inventé nombre d’automates et développé une ingénierie de pointe (1). Une de ses créations les plus étonnantes est un groupe de robots musiciens à bord d’une barque, servant des rafraîchissements aux invités. On considère qu’une autre de ses machines anticipe la programmation (2). Il est l’auteur du Livre de la connaissance des procédés mécaniques, qui décrit des douzaines de modélisations dans de nombreux domaines : hydraulique, médecine, ingénierie, mesure du temps, musique et divertissement. Les lieux où il a conçu tout cela sont désormais détruits.
La guerre, la construction et la destruction ont littéralement lieu derrière des écrans – à couvert : elles y sont programmées, établies. On a dessiné des plans. Plié et sculpté les lois. Les cerveaux, pris dans les phares de l’urgence médiatique permanente, ont été à la fois anesthésiés et excités. On a déployé les troupes ainsi que des architectes, la télé, des checkpoints, des coupures d’Internet et la bureaucratie. Le design de la mort orchestre des politiques dans le domaine militaire, du logement et – soutenu par la religion – de la population. Il jongle entre les registres fonciers, les passions exacerbées et les actes de harcèlement et de violence quotidienne. Il distille ses trolls, ses administrateurs, ses scoops et ses appels à la prière. Les gens sont déplacés par rotation de l’intérieur à l’extérieur des territoires, classés par affinité avec l’hégémonie du moment. Le design de la mort est lisse, participatif, progressif et agressif, il est soutenu par des tueries irrégulières et occasionnelles à la machette. Il est robuste, effronté, il recherche la pureté et le danger. Il rebat rapidement ses cartes alliées et ennemies. Il arase la différence et la dissidence. Il est asymétrique, multidimensionnel, écrasant, il domine depuis sa suprématie aérienne.
Après la fin des combats, le couvre-feu a continué. De grandes bâches en plastique blanc obturaient chaque entrée du site pour empêcher qu’on voie les anciennes zones de combat. On a fait entrer une armée de bulldozers. Construire, c’était continuer la guerre par d’autres moyens. Les décombres des bâtiments ont été enlevées par des ouvriers amenés de loin. La rumeur disait qu’elles étaient en partie jetées dans le fleuve, en partie stockées dans des décharges très surveillées, loin du centre ville. On disait que les parents creusaient en secret pour retrouver les corps de leurs enfants. Ils s’étaient joints au soulèvement et étaient portés disparus. Quelques vestiges de barricades subsistent encore dans les rues, imbibés de l’odeur des cadavres. Les forces spéciales arrêtaient toute personne qui faisait mine de prendre des photos. « On ne peut pas les effacer, a répondu l’une d’elle. Elles vont directement dans le cloud ».

Une vidéo 3D de la reconstruction prévue a été diffusée alors que la zone était encore sous couvre-feu. Des spectres générés par ordinateur y patrouillent dans une sorte de paysage de jeu propret, construit dans des styles traditionnels et omettant les signes des différentes cultures et religions qui ont peuplé la ville depuis l’antiquité. Au moyen d’un effet vidéo irrégulier imitant une page qui se tourne, la destruction y est remplacée par des aires de jeux riantes et des allées haussmannisées en images de synthèse.


Ces caches et contre-caches permettent de passer du présent au futur, de la municipalité élue à l’état d’urgence (3), des quartiers ouvriers à un immobilier dernier cri. La « page tournée » est un trucage vidéo symboliquement fort du point de vue politique. Une sorte de déplacement par effacement, ou plus précisément un remplacement. Elle introduit une nouvelle vue en poussant l’ancienne. Elle balaie visuellement la population initiale, les bâtiments, les élus et les droits de propriété afin de « dégager » l’espace et de le remplir d’une population plus convenable, d’un paysage urbain culturellement plus homogène, d’une administration et de propriétaires mieux harmonisés. D’après cette simulation, de nouveaux bâtiments coûteux imitant les modèles d’antan densifieront le vieux centre ville vide, en feront un lieu de consommation, de possession et de conquête. Le produit de ce genre de design est au final le peuple et, comme disait Brecht, sa dissolution (voire son élimination, si nécessaire). Le design de la mort est un coup d’Etat permanent contre ce qui ne se conforme pas dans le peuple, contre ce qui résiste dans les systèmes humains et leur économie.

Et donc, où est cette ville ? En Turquie. C’est Diyarbakir, considérée par les Kurdes de cette région comme leur capitale. Il y a des cas pires alentour. Ce qui est intéressant, ce n’est pas que ces choses-là se soient passées. Ce qui est intéressant, c’est qu’elles se produisent encore. Ce qui est intéressant, c’est que la plupart des gens pensent que c’est parfaitement normal. Le mécontentement fait partie du dessein général, ainsi que le sentiment que tout cela est trop difficile à comprendre et trop spécifique pour être élucidé. Pourtant, cet endroit semble « designé » comme un cas unique qui ne fait que suivre ses propres règles – s’il en a. Il n’a pas pour horizon une humanité partagée : il est conçu comme un cas singulier, une singularité à petite échelle (4).
Prenons à présent un peu de recul et essayons de tirer quelques conclusions générales. Qu’est-ce que cet exemple de design de la mort nous apprend plus largement sur la question du design ? On pensera peut-être au concept heideggerien d’être-pour-la-mort (Dasein zum Tode), l’enracinement de la mort dans la vie. De même on pourrait parler ici de « Design zum Tode », ou d’un type de design dont la mort est l’horizon global et qui produit une structure signifiante à la hiérarchie stricte et violente (5).
Mais il y a autre chose d’évident, et que la captation vidéo rend palpable : imaginez qu’on filme un bulldozer en train de détruire des bâtiments et de les réduire en poussière. Maintenant, imaginez la même séquence passée à l’envers. Elle montrera quelque chose de très étrange, à savoir un bulldozer qui construit un bâtiment. On verra la poussière et les gravats se contracter violemment en matériaux de construction. La structure se matérialisera comme si on l’avait tirée des airs au moyen d’une sorte d’aspirateur brutaliste. Ce que montre cette vidéo imaginaire est très proche de ce que j’ai décrit : c’est la parfaite représentation d’une sorte bien particulière de « destruction créatrice ».
C’est peu avant la première guerre mondiale que le sociologue Werner Sombart forge l’expression « destruction créatrice » dans son essai Guerre et Capitalisme (6). Durant la seconde guerre, l’économiste autrichien Joseph Schumpeter avance que cette destruction créatrice est « le fait essentiel du capitalisme » (7). Schumpeter s’inspire de ce que dit Marx de la capacité du capitalisme à dissoudre toutes sortes de structures apparemment solides, en les obligeant à se renouveler et à s’actualiser, de l’intérieur comme de l’extérieur. Mais pour Marx, la « destruction créatrice » n’en reste pas moins et avant tout un processus de destruction (8). Avec l’idéologie néolibérale, l’expression s’est répandue pour désigner une sorte de nettoyage interne nécessaire, qui permet de préserver productivité et efficacité. Ce destructivisme trouve un écho à la fois dans le futurisme et l’accélérationnisme, qui l’un et l’autre célèbrent en lui une sorte de catastrophe obligée.
Aujourd’hui, l’expression « innovation disruptive » a remplacé « destruction créatrice » (9). L’automatisation du travail des ouvriers et des employés, l’intelligence artificielle, l’apprentissage machine, les systèmes de contrôle cybernétiques ou les appareils « autonomes » sont des exemples de technologies dites disruptives, qui perturbent violemment les sociétés existantes et les marchés. C’est là qu’on en revient aux robots mécaniques de Al-Jazari, précurseurs des technologies de disruption. A quel type de design celles-ci sont-elles, le cas échéant, associées ? Quelles sont les technologies sociales de rupture ? Comment les coupures générales d’Internet, les trolls, les leaks ou les bots de Twitter sont-ils utilisés pour aider les autocraties à prospérer ? Comment les robots contemporains créent-ils du chômage ? Quid des systèmes des biens en réseau et des armes semi-autonomes ? Quid de l’imbécillité artificielle galopante, des systèmes déficients et des hotlines sans issue ? Quid de la démesure des grues et des bulldozers de Hyundai et Komatsu qui labourent les villes détruites dans un absurde ballet mécanique, emboutissant les ruines, déchirant le tissu social, effaçant les présents vivants pour construire à la hâte un néant accablant ?
L’innovation disruptive crée une polarisation sociale : elle décime les emplois, établit une surveillance de masse et génère de la confusion par ses algorithmes. Elle facilite la segmentation de la société par ses monopoles technologiques antisociaux : en résulte un ressentiment nébuleux, des changements d’urbanisme, le mépris général s’accroît et le travail précaire mal payé devient la norme. Parmi les effets de ces ruptures sociales et technologiques, on compte des mouvements de masse nationalistes voire nativistes, fascistes ou ultra-religieux (10). La disruption créatrice, alimentée par l’automatisation et le contrôle cybernétique, va de pair avec la fragmentation politique. Les forces du capital extrême, boostées par la haine tribale et fondamentaliste, se réorganisent en statistiques financières et en bulles de filtrage.
Dans la science-fiction moderniste, on imaginait que la pire sorte de gouvernement serait une unique intelligence artificielle contrôlant à distance la société. Aujourd’hui, les proto- et para-fascismes qui existent pour de vrai reposent sur une imbécillité artificielle décentralisée. Des armées de bots, la magie des memes et des fermes de serveurs constituent les boyaux neuronaux du sentiment politique : ils fabriquent des shitstorms qui se font passer pour la volonté du peuple. L’idéal de domination fasciste technocratique – censément détachée, omnisciente et sophistiquée – se concrétise par une volée de tweets abrutis. Et en guise de manifestation démocratique, on a une foule occupée à capturer sur son portable le mouvement, l’activité et l’énergie vitale de chacun. Mais contrairement à celles des dystopies modernistes, les autocraties actuelles ne comptent pas sur la perfection de ces systèmes. Elles profitent plutôt de leurs défaillances permanentes, leurs dysfonctionnements et les ravages de leurs capacités « prédictives ».

La disruption affecte en particulier le temps. Rappelons-nous la vidéo du bulldozer passée à l’envers : l’impression de création dans cette destruction ne vient que de ce que le temps est inversé et coule vers sa source. Après la chute du mur, Derrida a frappé les esprits en déclarant que le temps était « out of joint » et devenait fou. Des essayistes comme Francis Fukuyama ont pensé que l’Histoire était en quelque sorte finie. Lyotard a décrit le présent comme une succession de déflagrations dont rien de particulier ne résultait (11). A la même époque, la logistique réorganisait les chaînes de production mondiales en essayant de faire un montage de morceaux de temps disparates, afin de maximiser l’efficacité et le profit. Ce temps fragmenté, qui faisait écho à l’esthétique du copier-coller, a produit un vaste chaos pour les gens qui ont dû organiser leur vie autour d’horaires de travail de plus en plus impossibles, parcellisés et souvent non rémunérés.
A cela s’ajoute une dimension du temps qui n’est plus accessible à l’homme, mais seulement aux systèmes de contrôle qui produisent en réseau des krachs instantanés ou des arnaques commerciales simultanées. La financiarisation introduit bien d’autres complications : la viabilité de l’économie tient à la dette, c’est-à-dire au fait que les revenus à venir sont déduits ou dépensés au présent. Ainsi les futurs sont d’un côté appauvris et, de l’autre, les présents déstabilisés. Bref, le présent est perçu comme une vidange de l’avenir destinée à maintenir en boucle un passé qui n’a jamais existé. Ce qui signifie que, au moins sur certaines parties de sa trajectoire, le temps remonte en effet à sa source, d’un futur siphonné à un passé imaginaire et stagnant qu’il irrigue, avec l’aide du design disruptif.
Dans la vidéo 3D de la vieille ville, c’est la valse tremblotante des « pages tournées » qui signe la disruption. La transition entre présent et futur est abrupte et littéralement accidentée : les images semblent secouées par un tremblement de terre. En remplaçant une réalité urbaine vive que caractérisent des liens sociaux forts par une projection numérique aseptisée qui suppose un remplacement de la population, le design disruptif recouvre opportunément le chagrin et la dépossession d’une couche de pixels.
Dans la vieille ville, la guerre est loin d’être marginale ou périphérique : elle prend le visage d’une forme particulière de design disruptif, un design de la mort spécifique, une sorte de temporalité spéciale, celle d’une avant-garde naufragée. L’avenir est précipité, non par la dépense des recettes futures mais par la réalisation dans le présent des morts à venir. Une sorte d’application du mécanisme de la dette à ceux du contrôle militaire, de l’occupation et de l’expropriation.
Tout en rêvant à une technologie singulière qui rendrait une fois pour toutes l’humanité superflue, la disruption, en tant que processus social, esthétique et militaire, crée d’innombrables petites singularités, des entités piégées dans les rets de ce que les autocrates déclarent être leur Histoire, leur identité, leur culture, leur idéologie, leur race ou leur religion : chacune avec son ensemble incompatible de règles ou, plus précisément, son manque incompatible de règles (12). La « disruption créatrice » ne se réalise pas seulement dans la destruction des bâtiments et des zones urbaines. Elle ambitionne l’anéantissement d’un horizon commun de compréhension, qu’elle remplace par des Histoires artificielles : étroites, parallèles, verticales, soigneusement découpées et javellisées.
C’est très exactement ainsi que les processus de disruption pourraient vous affecter, même si vous ne vivez pas là. Non pas que vous serez nécessairement exproprié, « déplacé » ou pire. Cela peut arriver, ou pas, selon où (et qui) vous serez. Mais vous aussi, vous pourriez finir piégé dans la singularité infernale d’un futur rejouant des passés inventés, avec une moitié de la population qui cherche à se débarrasser de l’autre. Les gens regarderont de loin, concluront qu’ils ne peuvent pas comprendre et continueront à regarder des chatons sur Instagram.
Que faire alors ? Quel est le design inverse, le type de création qui puisse assister des formes de vies protéiformes et horizontales, et qui puisse s’inscrire dans une humanité partagée ? Quel est le contraire d’une démarche fondée sur l’inflation, l’accélération, l’épuration, la disruption et l’homogénéisation ? D’un processus qui conçoit l’humanité comme un produit uniforme, purifié et prétendument supérieur, une surhumanité composée de spectres 3D aseptisés ?
Le contraire, c’est un processus qui ne croît pas par la destruction mais très littéralement décroît de façon constructive. Ce type de construction ne crée pas d’inflation mais au contraire une décentralisation. Non pas une compétition centralisée mais une autonomie coopérative. Elle ne morcelle pas le temps ni ne divise les gens : elle réduit l’expansion, l’inflation, la consommation, la dette, la disruption, l’occupation et la mort. Ce n’est pas la surhumanité : l’humanité telle qu’elle est lui suffit.
Une femme était restée seule dans la vieille ville durant tout le temps du couvre-feu pour s’occuper de sa vache, qui était à l’étable. Chaque semaine, ses filles escaladaient une cascade dans l’ancienne enceinte romaine pour venir la ravitailler. A chaque fois, les soldats leur tiraient dessus. Ça a duré des semaines et des semaines. Quand on les a rencontrées, la vache venait de mettre bas. L’un des membres de notre équipe était vétérinaire.
Une des filles : Notre veau est malade. S’il vous plaît, venez voir.
Le vétérinaire : Bien sûr, que s’est-il passé ? C’est un nouveau-né ? Est-ce qu’il a bu le premier lait de sa mère ?
La mère : Non, il n’a pas eu le colostrum. Il n’y avait pas de lait. La mise bas a été difficile. Elle s’y est repris à cinq fois.
La fille : L’autre veau est arrivé le premier et il a bu tout le lait, on ne s’en est pas rendu compte.
L’autre fille : Maman, où est le veau ?
La mère, en direction de l’étable : Où il est ? Mon petit Pistache, t’es où ?