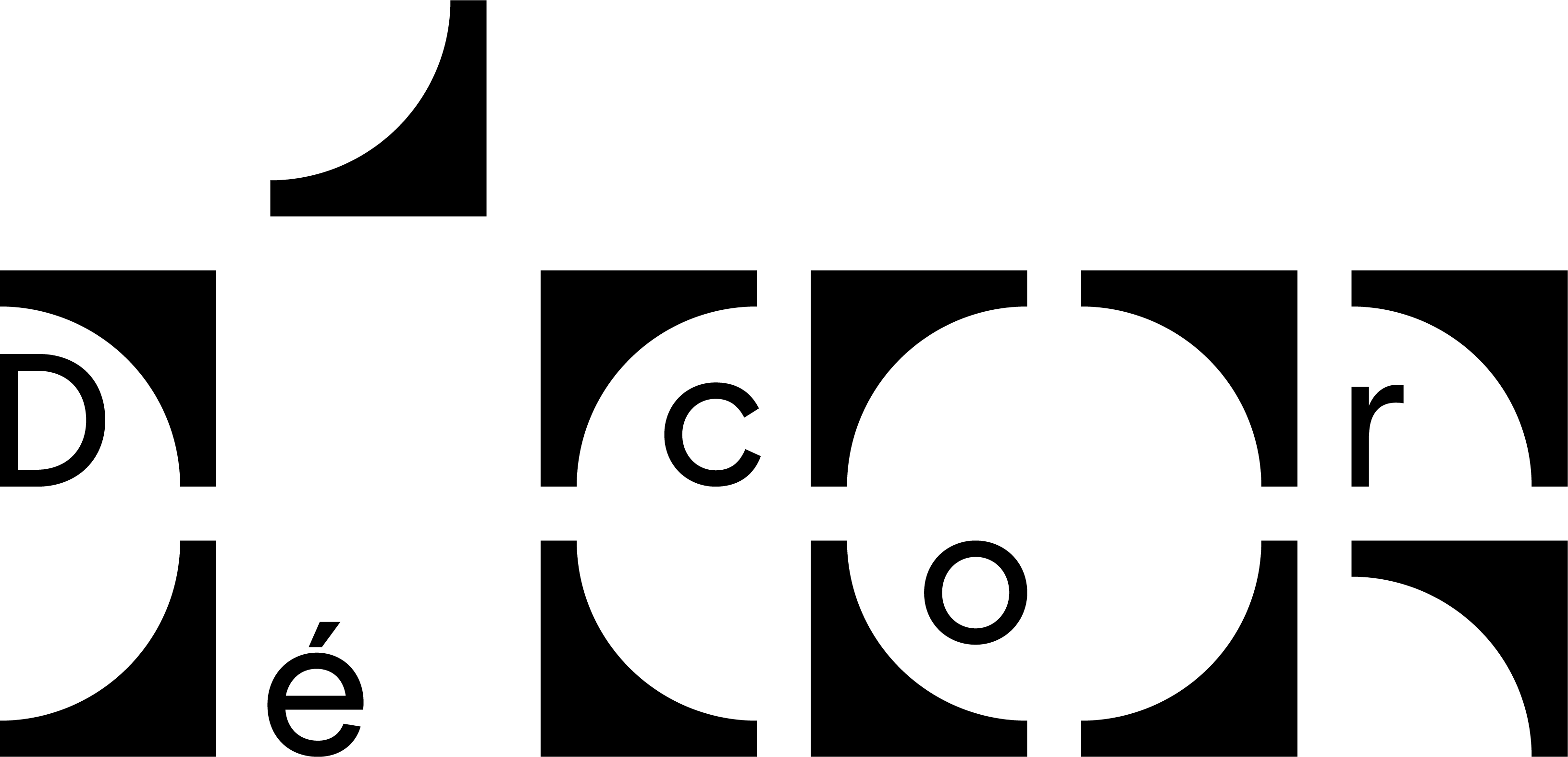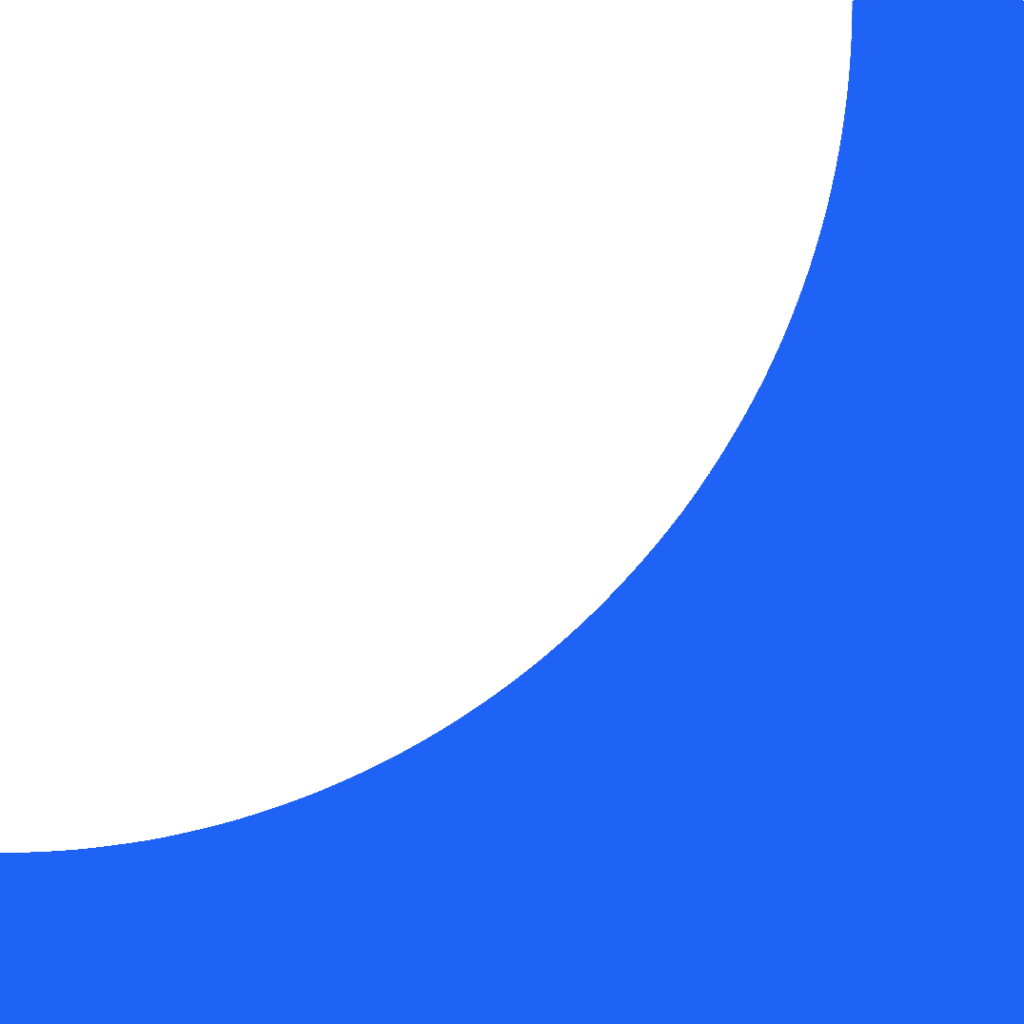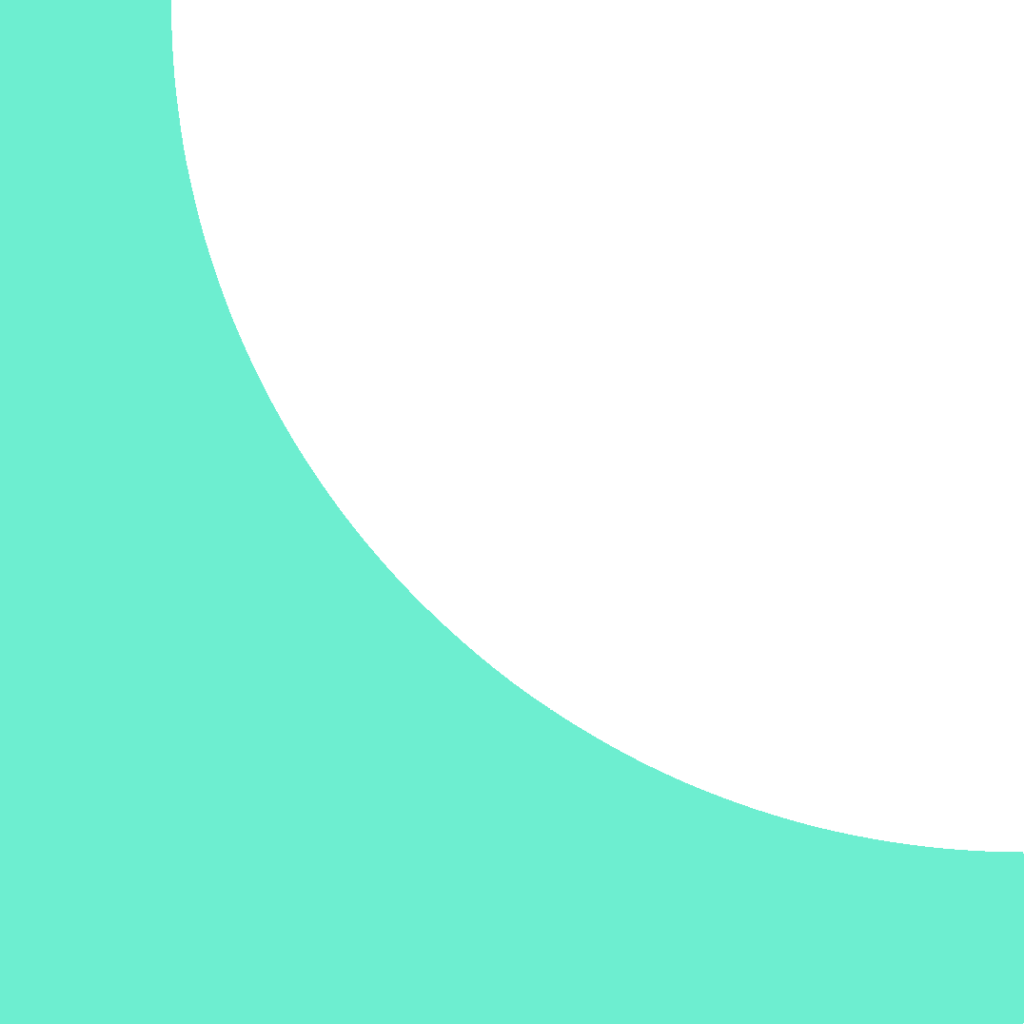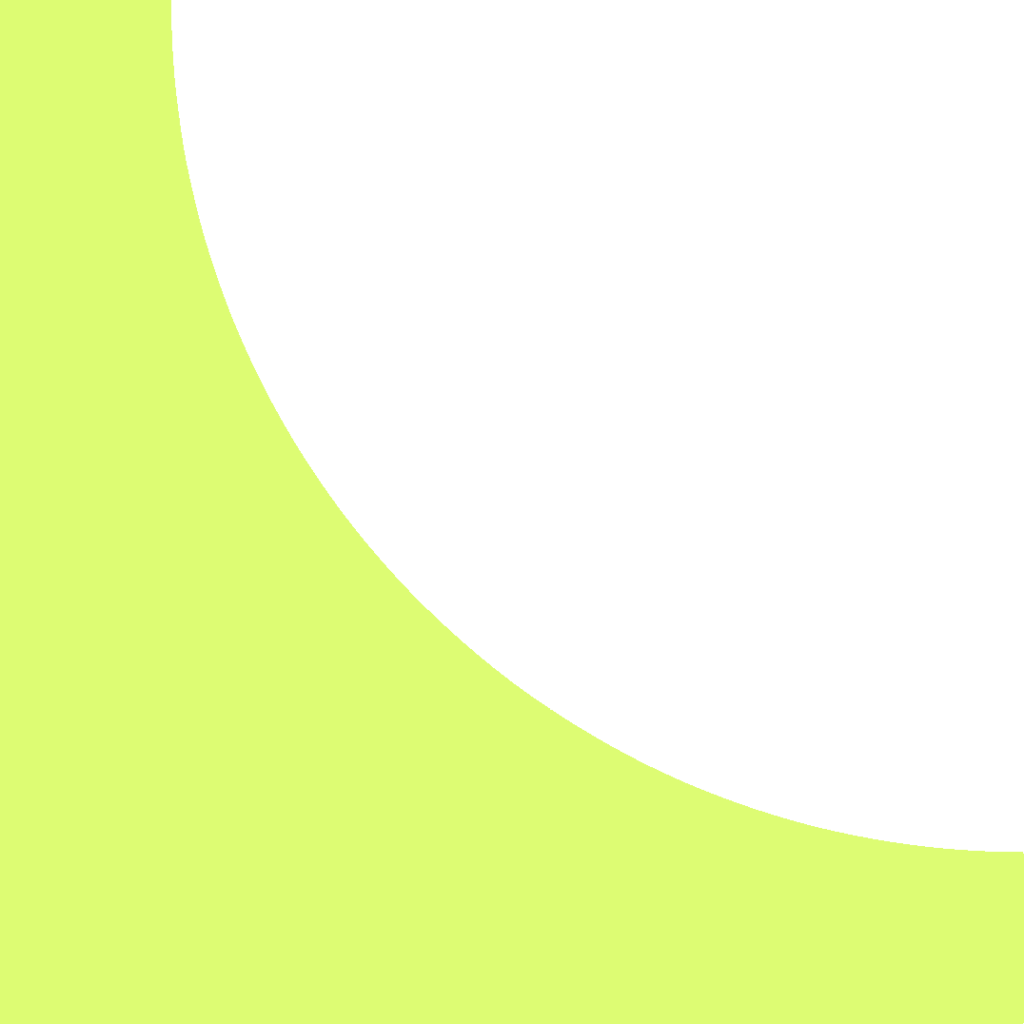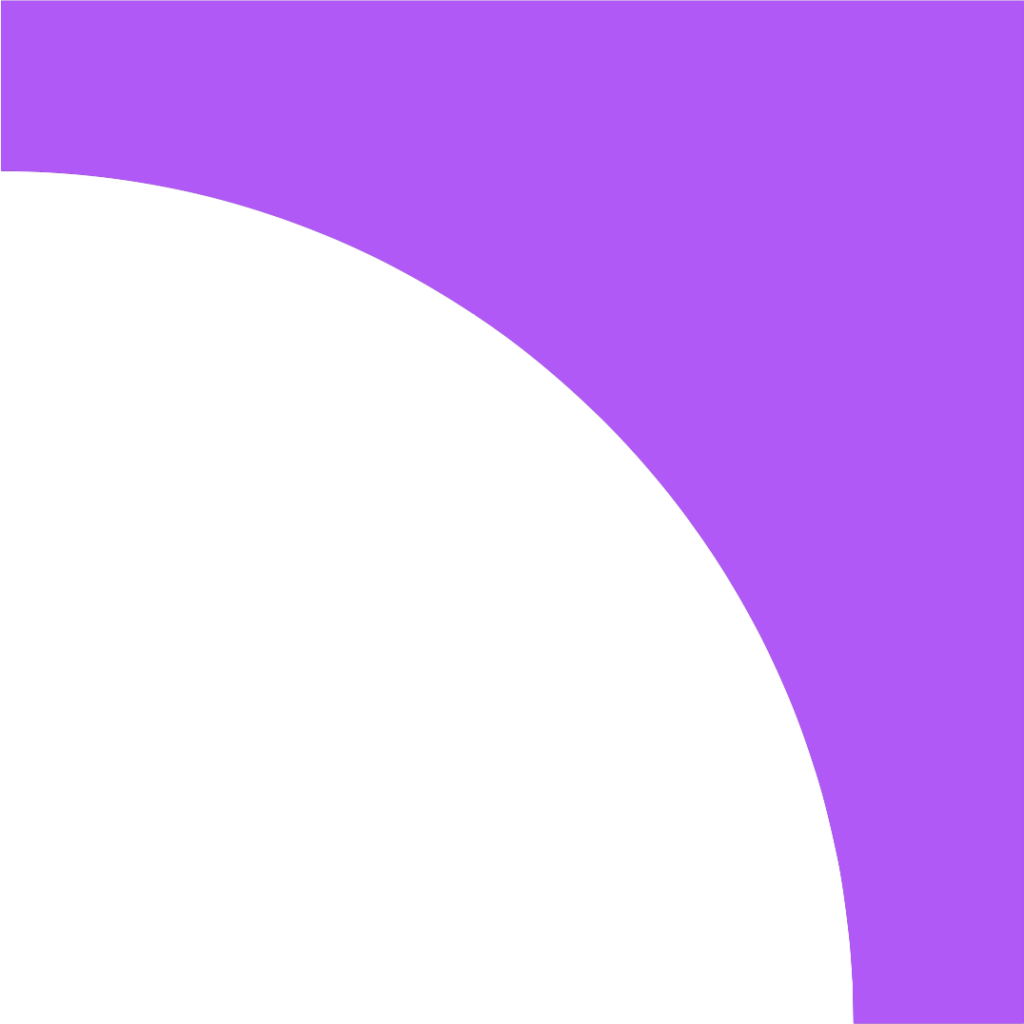Ce temps, perçu parfois comme catastrophique au sens littéral – c’est-à-dire comme renversement et fin –, a contraint les artistes et designers, privé.e.s de leurs ateliers ou des outils leur permettant de réaliser des œuvres matériellement complexes, à se tourner vers une forme de production plus instinctive et bricolée.
Autodidactes à l’usage du numérique et à la médiation de leurs travaux via les réseaux sociaux, ielle.s ont infusé plus que jamais la toile de leurs pratiques, continuant ainsi de créer et d’imaginer de nouvelles formes de partage pour « l’après ». D’où l’idée de proposer, pour cette quatrième émanation de notre abécédaire du décor contemporain, « D comme DIY », treize expositions fictives et vidéographiées, réalisées en trois semaines pendant la période de confinement par des artistes né.e.s vers 1993.
Le DIY (Do it yourself) est l’art de créer à partir de ce qu’on trouve autour de soi, sans faire appel à des experts ou des professionnels: en français, « système D » comme « Débrouille ». Cependant, il dépasse de loin le simple « bricolage ». L’état d’esprit de cette pratique s’est tissé au cœur des mouvements de contre-culture des années 70, devenus pour certains un positionnement politique (Jerry Rubin publie en 1973 Do It ! Scénarios de la révolution), une éthique de vie ou une pratique sociale. On gardera également à l’esprit que l’un des objets iconiques de cette pratique reste le WHOLE EARTH CATALOG, access to tools, catalogue américain publié entre 1968 et 1972 par Stewart Brand, visant à rendre innovations et techniques accessibles au plus grand nombre, sorte de version 1.0 des fichiers open source.
Dans une continuité logique sera fondée en 1985 la communauté virtuelle : the WELL (Whole Earth ‘Lectronic Link) par le même Stewart Brand, avec Larry Brilliant. Véritable pendant internet des communautés hippies de cette époque, the WELL devient le refuge des espérances militantes des années 70 et entend investir cet espace virtuel avec les mêmes logiques de lien social et de partage des connaissances pour un apprentissage collectif et collaboratif: ce sera la Déclaration d’indépendance du cyberespace de John Perry Barlow (1996).
Car le DIY est aussi une philosophie de l’autocapacitation (ou selfempowerment) et de la réparation, philosophie née il y a plus de cent ans au temps de l’industrie et du commerce, afin de s’en libérer. Vilém Flusser dans Choses et non-choses (1993) en fait le parangon de « l’engagement » moderne face à « l’ordure » qui est notre condition: « la transmutation révolutionnaire permanente des bouteilles conservées », par exemple en vases ou en cendriers. Ce qu’on appelle aujourd’hui l’upcycling ou surcyclage. Mais toute dissidence demeurant assujettie à ce dont elle se sépare, le DIY garde de son origine émancipatrice une ambiguïté essentielle. Et il correspond aussi bien à la phrase célèbre de Thomas Edison, qu’on ne soupçonnerait guère d’être contre l’entrepreneuriat et le productivisme: « Pour inventer, il faut une bonne imagination et un tas d’ordures (a pile of junk) ».
Dans notre exposition virtuelle, les artistes et designers ont été invité.es à investir la Fondation d’entreprise Ricard sous forme de fictions courtes et vidéographiées. Dans cet espace nu, l’habillage en trois dimensions appelle l’imperfection bricolée, l’illusion théâtrale, les architectures foraines ou encore des levels oniriques de jeux vidéos… Des espaces parfois autant déconnectés du réel que leurs propos sont ancrés dans nos problématiques sociétales. Enfants conscients ou non de cette culture DIY, les artistes ici présenté.es prolongent cette volonté d’auto-apprentissage et de partage comme vecteur de leur création, valeurs fortes qui ont forgé ces trois lettres.