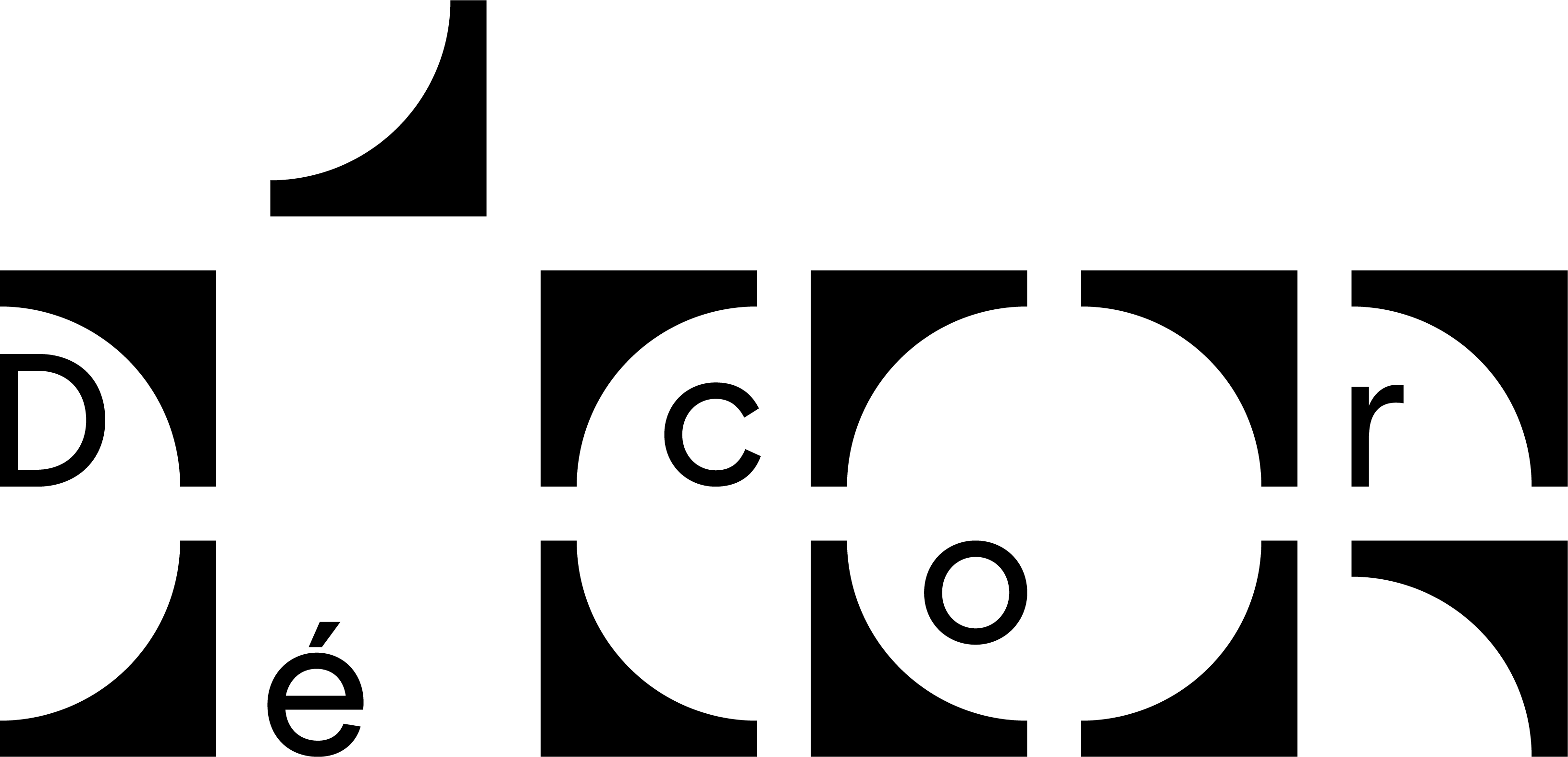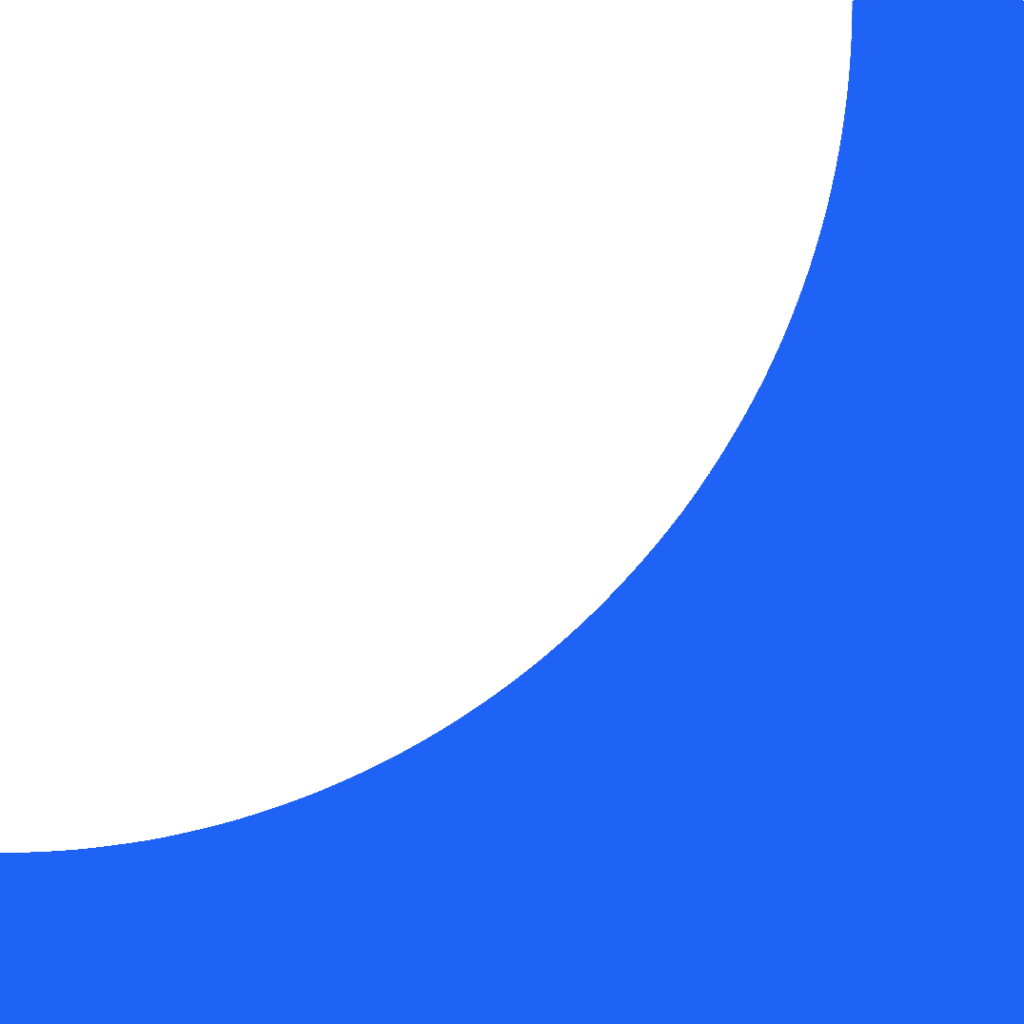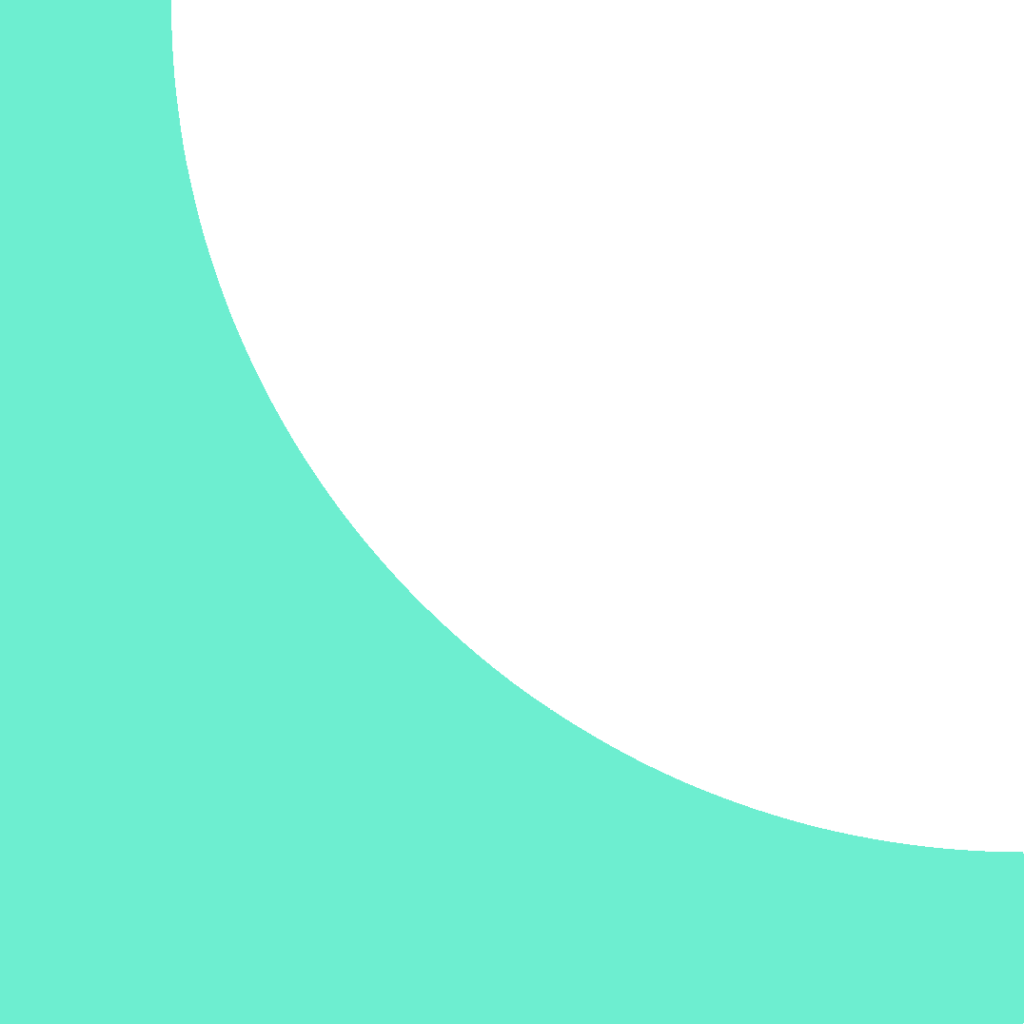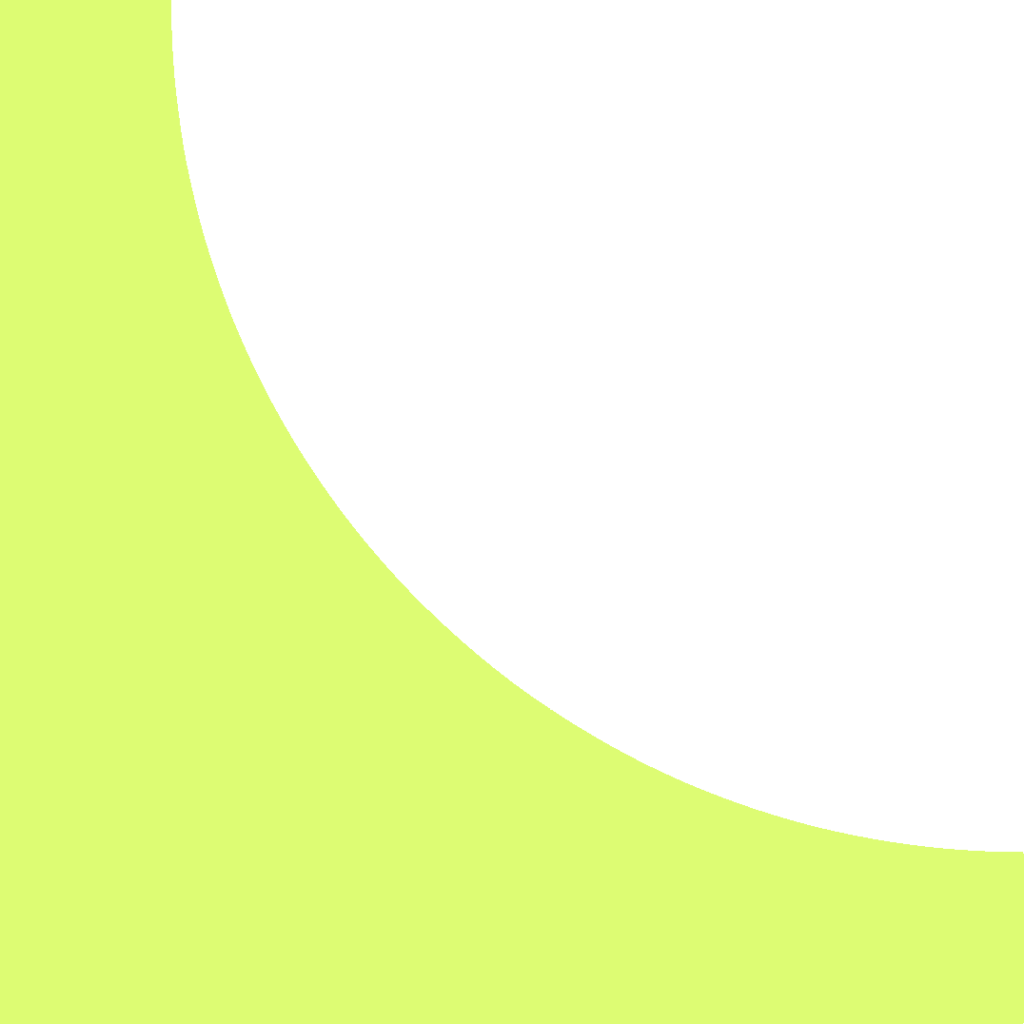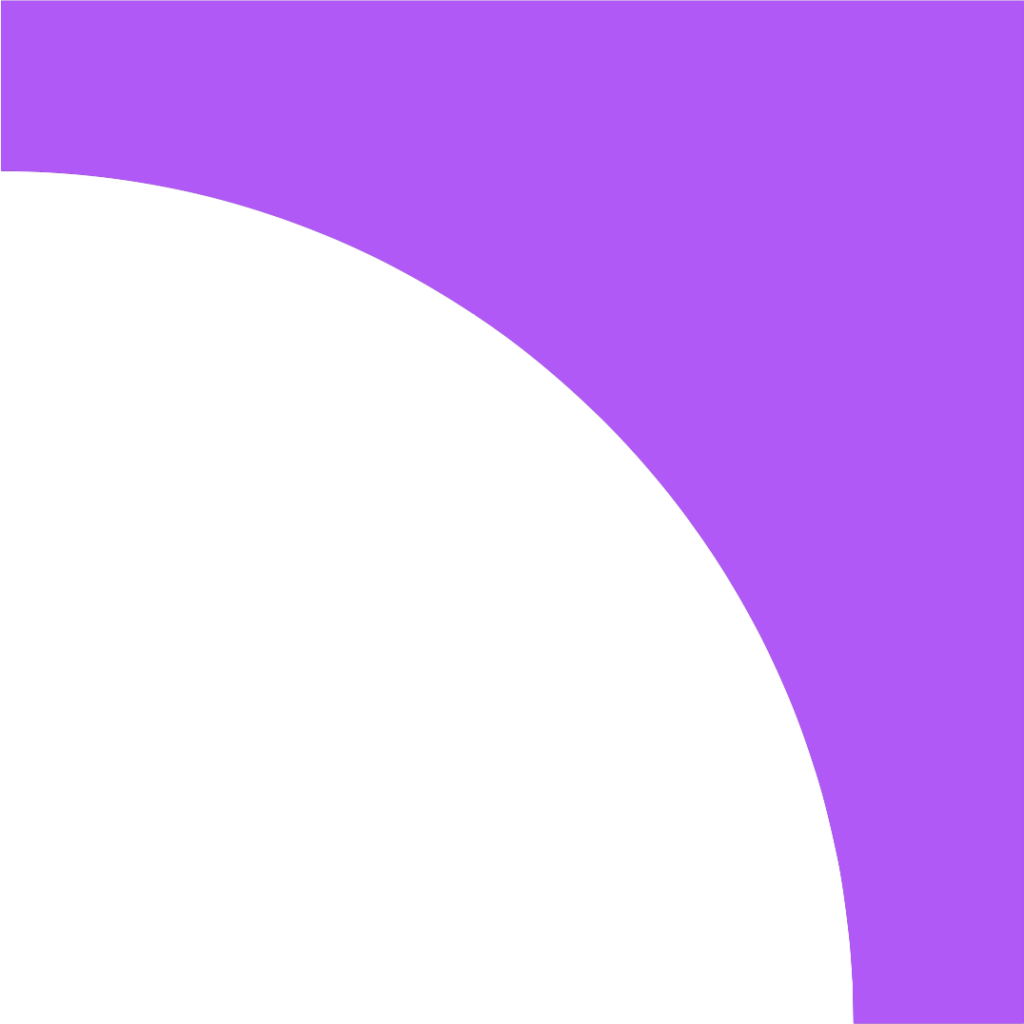Il y a Gen et il y a Mili. Il y aussi Alfred, une hémorroïde un peu encombrante, sur le dos de Mili. Les deux jeunes femmes font un pélerinage dans les sous-bois, à travers champs. Elles se nourrissent de fortune cookies. Alfred se contente d’air. Comme c’est un road movie à pieds et au ralenti (quatre kilomètres par jour), elles rencontrent des gens : un père de famille qui leur parle des miracles de Montoussé (Hautes-Pyrénées) ; un monsieur Jean-Michel qui a perdu son chat ; un autre qui leur prête un âne, indispensable pour un vrai pélerinage, même si celui-ci n’a, de l’aveu des protagonistes, aucun but défini. Enfin, il y a Ramón Churruca, bien sûr, qui solutionne tous leurs problèmes.
Sous ses airs fantasques, How Glorious it is to Be a Human Being (2018) de l’Israélienne Mili Pecherer traite sérieusement le sujet de son titre : la gloire d’être humain — et la difficulté d’exister. Récompensé au FID, ce moyen-métrage constitue en quelque sorte la suite de La vie sans pompe (2017), inédit, qui voyait le début des aventures d’Alfred et Ramón. On retrouverait l’année suivante la jeune vidéaste en habits de pèlerine dans It wasn’t the Right Mountain, Mohammad (2019), un court en CGI sur le sacrifice d’Isaac, réalisé comme How Glorious… au Fresnoy. Et ce printemps, Mili Pecherer fera partie de l’exposition de Bertrand Dezoteux à la Fondation Pernod Ricard, « Le Juste Prix ».
Pout tout savoir, on a proposé un entretien sous forme d’abécédaire à l’artiste. On a un peu triché, lui envoyant la liste des mots deux jours avant qu’on ne se rencontre en visio.
On commence par A comme « Autobiographie ». Dans ta pratique de documentariste, il y a toujours une part autobiographique. Ou du moins, c’est un mot que tu emploies pour qualifier ton travail au début de La vie sans pompe.
Il y a un terme que j’aime mieux que celui d’autobiographie et que j’ai trouvé chez Pontalis, c’est « autographie » : dans mes films, je crée de nouvelles situations réelles, que je n’aurais pas vécues sans eux. C’est à moi que cela arrive, mais cela ne fait pas partie de ma vie quotidienne. Le documentaire permet de créer un cadre, des règles du jeu et une fois que c’est lancé, la réalité et la vie font ce qu’elles veulent de moi et de mon film. J’essaie de pratiquer cela, d’ouvrir mes bras et de dire au monde : « fais ce que tu veux de moi ». Ce n’est jamais évident, je ne suis pas zen sur les tournages, je suis plutôt très angoissée et déçue mais ensuite je me dis que c’était un beau moment. C’est une manière de rencontrer le monde tel qu’il est. Ce qui n’est pas possible dans le quotidien, car on nous apprend que nous sommes maîtres de notre destin et qu’en travaillant dur on obtiendra ce qu’on veut mais… c’est assez faux.
Quand tu te représentes en 3D dans It wasn’t the Right Mountain, Mohammad, est-ce que c’est encore de l’autographie ?
Je ne sais pas percevoir le monde à travers les yeux de quelqu’un d’autre, et je n’ai pas le courage de prendre des décisions philosophiques pour d’autres. Donc c’est compliqué pour moi de créer des personnages de fiction. Je trouve plus honnête de montrer comment je vois les choses depuis mon point de vue… Je m’étais dit que la 3D était l’occasion de me libérer de mon personnage de Mili, que j’allais raconter l’histoire biblique d’Isaac par les yeux du bélier qui a été sacrifié à sa place et que j’allais accéder à un stade spirituel supérieur… (rires). Mais plus je travaillais et moins j’avais le courage de prendre cette position. Finalement, je me suis scannée et je suis devenue un avatar, ce qui a été la seule manière pour moi d’entrer dans cette histoire complexe. Et c’est devenu un film sur ce que j’aurais vécu si j’avais été présente le jour du sacrifice, le dernier jour du bélier. Pour la mise en œuvre, j’ai créé un jeu vidéo sur mesure, et j’y ai ensuite joué, j’ai erré dans cet univers synthétique, un peu comme dans un documentaire, tout en enregistrant l’écran.
J’ai utilisé le même procédé pour Tsigele-Migele qui sera présenté à la Fondation Pernod Ricard.
Continuons avec A comme « Animal ». Il y a des animaux dans chacun de tes films, tu essaies de donner leur point de vue, par exemple en fixant une caméra sur l’âne de How Glorious…
Bambou l’âne dans How glorious… était censé être un des personnages principaux, nous voulions que son regard (grâce à la GoPro sur sa tête) montre toutes les choses que nous, les humains, ne voyons pas. C’est la huitième élégie de Rilke : « De tous ses yeux la créature voit / l’Ouvert. Seuls nos yeux sont / comme retournés et posés autour d’elle / tels des pièges pour encercler sa libre issue. / Ce qui est au-dehors nous ne le connaissons que par les yeux / de l’animal ». Mais le pauvre Bambou a été blessé au sabot après notre première journée de tournage, et n’a pas pu nous rejoindre comme nous le souhaitions. Nous sommes donc restées, Gen et moi, presque comme les seuls miroirs l’une de l’autre.
Chez Lucien Lévy-Bruhl et Benjamin Fondane, il y a aussi cette idée qu’avant que nous, les humains, nous ne soyions civilisés et adoptions la « raison » comme règle, nous vivions dans un monde où toutes les créatures étaient égales. Il y avait des forces supérieures, des esprits, qui contrôlaient le monde et se manifestaient en chacun des êtres de la terre. Nous étions tous connectés et il n’y avait pas de « causalité » car tout dépendait de ces esprits : par exemple, si l’on décidait d’aller à la chasse, on cherchait les oiseaux ou les nuages et la direction de leur vol déterminait si l’on devait poursuivre la chasse ou essayer un autre jour. Personne ne pensait que les crocodiles étaient des créatures dangereuses. Si vous laviez vos vêtements au bord de la rivière et qu’un crocodile vous dévorait, c’était à cause de la sorcellerie ou des esprits. Et de même, les rêves disaient la vérité, ils n’étaient pas un effet neuropsychologique parmi d’autres. C’est peut-être facile d’avoir la nostalgie de cet état supposé de l’humanité, mais j’avoue que c’est mon cas. Je crois que, dans le processus de création, je cherche ce monde perdu : pas forcément de façon consciente, mais parce que je me bats avant tout contre le raisonnement et la causalité.
La deuxième chose quant aux animaux c’est que souvent, dans les récits bibliques, il y a trois noms différents pour Dieu : Elohim, Yahweh et celui d’un ange ou d’un animal. Quand un personnage dit « Que pouvais-je faire ? Yahweh m’a ordonné de faire ça… » , on comprend qu’il ne peut pas aller contre… C’est un peu comme le Ça en psychanalyse… C’est le nom du dieu qui est chargé des événements dans le monde physique/naturel. Elohim est une autre entité, celle qui a des conversations intimes avec les héros, une voix intérieure : le Moi. Puis, lorsque le héros est au plus profond de sa dissonance cognitive, comme Abraham qui croit qu’il doit tuer son fils, lorsque son Ça et son Moi se battent et qu’il est sur le point de se perdre, le Surmoi vient créer l’ordre. Ce sera sous la forme d’un animal ou de l’ange de dieu, peut-être les deux, qui apparaîtront dans l’histoire et permettront au monde extérieur d’entrer dans l’âme tourmentée du héros, celui qui a les yeux enroulés autour de lui à cause de son combat intérieur. Ils apaiseront son âme tourmentée avec une solution finalement assez banale. Dans le cas d’Abraham, c’est un ange et pour Balaam, dont je me suis inspiré pour How Glorious…, c’est son ânesse qui lui parle. Les histoires bibliques que j’aime ont tendance à se terminer par un anticlimax total, la montagne accouche d’une souris.
Il y avait B comme « Bible » de prévu, mais on va passer directement à B comme « Belief », « foi », « croyance »…
La religion ne m’intéresse pas, mais la foi… je ne comprends pas comment j’ai pu penser qu’on pouvait vivre sans. Il y a eu un moment où je ne m’intéressais pas vraiment au monde, et c’est venu petit à petit. Avec les films. Dans la création, je ne vois pas ce qu’il peut y avoir d’autre que de la foi, parce qu’on fait quelque chose d’inutile, sans nécessité, personne ne nous a rien demandé, mais — je ne sais pas si ça se dit en français — on se suicide dessus : tu fais tout pour que le film sorte, et à la fin tu ne peux même pas toucher l’œuvre, c’est un fichier… Donc il faut avoir un dialogue, pas forcément avec dieu, mais avec quelque chose de plus, qui t’accompagne… Sinon c’est très compliqué dans un monde matérialiste, de produire l’exact contraire. Comme tu m’as parlé de Kierkegaard l’autre jour, j’ai révisé le texte de 1849 que j’ai utilisé, Ce que nous apprennent les lis des champs et les oiseaux du ciel. C’est un texte magnifique qu’on peut relire à différents moments de sa vie et qui à chaque fois procure un sens différent. C’est pour les gens inquiets et ça parle beaucoup du travail. Pour Kierkegaard, l’inquiétude nous tue de l’intérieur, car elle est un désir de domination, de contrôle, ce qui est une contradiction en soi. Et nous humains, selon le philosophe, nous ne nous rendons pas service les uns aux autres pour diminuer cette inquiétude car nous faisons appel à la raison mais, dit Kierkegaard, c’est comme donner de l’alcool à un alcoolique. La vraie solution, c’est de sortir dans les champs pour rencontrer deux maîtres que Dieu nous a laissés sur terre : le lis et l’oiseau du ciel. On peut leur faire confiance car ils ne sont pas créés par l’homme : ils nous apprennent à ne pas nous comparer aux autres et ne pas s’inquiéter du lendemain. Ce qui ne veut pas dire qu’on ne doit pas se préparer. Ce n’est pas du stoïcisme et le contrôle du désir, c’est le contraire : il faut libérer notre désir et c’est grâce à la foi qu’on peut le faire. Alors certes, le lis et l’oiseau n’ont pas travaillé pour être ce qu’ils sont, mais nous, nous avons la capacité du travail, comme Dieu, puisqu’il nous a fait à son image : et donc, il faut concevoir ce travail comme la continuation de celui de Dieu, avoir cette idée que ce nous mettons dans le monde doit continuer un peu la création. C’est une idée qui me soulage beaucoup, parce que ce n’est pas du point de vue économique que je peux justifier mon travail… ! Si je suis partie avec Gen sur la route, c’est aussi parce qu’elle est très posée, qu’elle prend son temps pour répondre ou bien qu’elle répond par une question, comme les lis et les oiseaux, dit Kierkegaard, qui nous consolent parce qu’ils sont silencieux. On croyait qu’on allait avoir des conversations très philosophiques et en fait, on laissait la caméra allumée et on marchait et on ne disait rien. J’avais acheté des fortune cookies au cas où, heureusement… (rires).
C comme « Churruca ». C’est un artiste-performeur basque espagnol qui apparaît dans La vie sans pompe et à la fin de How Glorious…
Avec Churruca c’était compliqué, comme on peut voir dans La vie sans pompe… Et depuis How Glorious… on ne se parle plus. Je crois qu’il l’a trouvé nul, mais ce n’est pas grave, je pense qu’on s’aime toujours. Nos personnages sont dans une telle contradiction que c’est tout simplement beau. Mais c’était très difficile.
Bon alors, comme on a déjà fait E comme « Existence » avec Kierkegaard, on pourrait passer directement à F comme « Fake », car je ne comprends pas exactement qui est Churruca: c’est vraiment un mage ou un baptiseur en plus d’un artiste ? Cela fait partie de son art ?
Mais comment sait-on si quelqu’un est « vraiment » baptiseur ? Je ne crois pas que cela fasse partie de ses performances et il n’offre pas ses services pour cela. Mais il a baptisé mon hémorroïde, donc il est de fait baptiseur. J’étais en résidence à BilbaoArte quand j’ai rencontré Ramón, j’attendais mon hémorroïde qui venait de Chine et ça l’a intéressé, il m’a proposé de venir dans son village pour la baptiser et j’ai filmé, c’est ce qu’on voit dans La vie sans pompe. Mais comme j’ai toujours l’impression d’échouer, j’essaie à chaque film de refaire ce que j’ai raté dans le précédent. La vie sans pompe est composé de moments que j’ai reliés de force par les conversations téléphoniques avec Churruca, parce que je savais qu’il devait arriver à la fin. C’est déjà une sorte de pélerinage. Donc en voulant refaire, pour How Glorious… il devait y avoir Churruca avec nous durant tout le pélerinage en plus de Bambou, mais finalement ça n’a marché ni avec l’un ni avec l’autre.
Revenons en arrière, pour D comme « Danger », car tu rencontres souvent des gens qui ne sont pas forcément bien intentionnés. Dans Yeruham Off Season (2013), tous les hommes te font des propositions sexuelles sous prétexte de t’offrir un hébergement pour dormir (sleep)… Il y a une scène identique dans La vie sans pompe. Ça pourrait rejoindre G comme « Genre », d’autant que tu ne rencontres jamais aucune femme dans tes films…
Je n’avais pas vu que c’était pareil dans les deux films, mais c’est vrai. Et pour les femmes… je ne sais pas. Je ne me suis jamais sentie en danger, sans doute grâce à la caméra, parce que c’était moi le chasseur. Ça change le rapport de pouvoir : en un sens, plus ces types étaient dégueulasses, mieux c’était pour le film. Dans la vraie vie, je serais partie après avoir entendu des remarques comme celles qu’ils font, mais ce n’est pas la vraie vie, c’est un film, donc je reste, et à la fin les barrières entre eux et moi tombent un peu et, finalement, il n’y a rien eu de mal. Mais peut-être que c’est de la stupidité de ma part.
C’est ce qui s’est passé au tout début du tournage de Yeruham. C’était le dernier jour avant le rendu pour mon cours de cinéma, je suis descendue dans la rue assez désespérée car je n’avais pas d’idée. Il y avait un chaton un peu mal foutu, je me suis dit « Tant pis, je serai la fille qui a filmé un chaton… » Et puis un homme est arrivé, qui a commencé à m’emmerder, pas méchamment mais quand même. Et j’étais concentrée sur mon film et mon rendu et je voulais juste qu’il s’en aille. Ce n’est que quand je suis rentrée chez moi que j’ai découvert qu’il s’était passé quelque chose en plus de ce que je croyais avoir filmé. C’était comme un troisième œil qui avait capté autre chose. Un film, à la fin, il me semble que c’est cet espace qui reste entre ce que tu voulais au départ et ce qui existe dans le monde, même si c’est un monde virtuel.
Ça correspond presque à H, non pas comme « Hémorroïde » mais comme « Hôte », qui est un mot étrange en français, puisqu’il désigne à la fois l’invité.e et celui ou celle qui est hospitalier. Un peu ce que tu dis de la rencontre documentaire avec le monde.